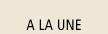

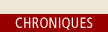
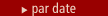
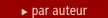

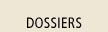
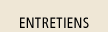
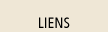
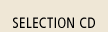
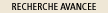

|
 |
|
CHRONIQUES
|
11 mai 2025
|
 |
Double Ă©vĂ©nement parisien dĂ©cembre dernier Ă la CitĂ© de la Musique, Nikolaus Harnoncourt fĂȘte ses 70 ans et se produit deux jours d'affilĂ©e. Et pourtant, la salle est si loin d'ĂȘtre pleine que l'on prie les Ă©garĂ©s du troisiĂšme de se rabattre d'un Ă©tage. Si dĂ©choir du poulailler atteste usuellement d'une ascension sociale, il y avait toutefois de quoi tomber de sa chaise. On doit en effet tant Ă cet artiste que la dette n'est plus estimable, et surtout pas Ă la hauteur d'un plafond ou d'un parterre comble. D'abord parce que le public prĂ©sent, lui, fut Ă la fois comblĂ©, mĂ©dusĂ© et rivĂ© Ă son fauteuil comme Ă un radeau en pleine tempĂȘte. Ensuite, parce que les absents ont forcĂ©ment tort, par dĂ©finition. Tort d'avoir peur d'un programme panachĂ© (Haydn, Bartok, Dvorak) dont a priori Harnoncourt ne serait pas familier. Pourtant, avant de se lancer dans l'aventure baroque, le jeune violoncelliste Nikolaus Harnoncourt Ă©tait d'abord un spĂ©cialiste de Strauss ou Dvorak. Tort aussi de ne pas suivre les yeux fermĂ©s  mais les oreilles grandes ouvertes - cet explorateur d'un genre nouveau : il ne dĂ©friche que des terres labourĂ©es et archi-cultivĂ©es, et pourtant chacunes des contrĂ©es qu'il a investies se sont rĂ©vĂ©lĂ©es successivement vierges puis arables. Et dĂ©sormais, son champ d'investigation semble s'Ă©tendre Ă perte d'ouĂŻe. Bien sĂ»r, on peut en apprĂ©cier diversement les fruits, certains paraĂźtront ici trop Ăąpres, lĂ trop riches. Qu'importe, car la plupart restent des plus goĂ»teux, et leur rĂ©colte a constituĂ© autant d'aventures irremplaçables. Des expĂ©riences sans lesquelles les mĂ©lomanes auraient pĂ©ri d'ennui, tranquillement dĂ©vorĂ©s par le confort de leurs charentaises musicales.
Quelle est donc la bonne hauteur pour apprĂ©cier la dette que chaque mĂ©lomane doit Ă Nikolaus Harnoncourt ? Peut-ĂȘtre celle de ces fameuses sphĂšres dont l'harmonie est, dit-on, garante de la voĂ»te cĂ©leste. Car la force unique de ce chef est de savoir invoquer cette harmonie, pour la dynamiter l'instant d'aprĂšs, et mieux la rĂ©tablir Ă nouveau avec la mĂȘme soudainetĂ© qu'il l'avait Ă©vanouie. Le sens du relief d'une partition est pratiquement un sixiĂšme sens chez lui. Mais plus encore, il a imposĂ© Ă toute une gĂ©nĂ©ration de musiciens, cette idĂ©e que la beautĂ© d'une mesure est d'autant plus vive qu'elle est entourĂ©e de passages moins beaux, voire carrĂ©ment laids, mais dont la laideur mĂȘme est Ă©loquente. Chez Harnoncourt, si un chanteur prononce un mot disgracieux, le timbre de sa voix doit devenir aussi repoussant que le vocable. L'antithĂšse mĂȘme du Bel Canto, nĂ© il faut le rappeler au XVIIe siĂšcle Ă Naples, par rĂ©action face aux excĂšs expressifs de la gĂ©nĂ©ration post-MontĂ©verdienne. Aucune voix cependant dans la grande salle de la CitĂ© de la Musique en ce dĂ©but dĂ©cembre 99, sinon un conciliabule Ă©manant du plafond mĂ©tallique truffĂ© de projecteurs, lesquels devisent et sifflotent paisiblement Ă tous les concerts. Tous ? non. Car ce diable d'Harnoncourt ne les a pas laissĂ©s concerter un instant. Sa symphonie militaire de Haydn les a enflammĂ©s,
aveuglés puis carbonisés. Le molto adagio du Divertimento (Sz113) de Bartok les a vitrifiés, puis évanouis en fumée. Enfin les Danses Slaves de Dvorak en ont dissipé les volutes dans une chorégraphie millimétrée et virevoltante. Quant à l'effet sensuel - au sens littéral -, sur les tympans humains, seul le loup de Tex Avery est capable de le figurer.
|
 |
|

|
Le 09/12/1999
Eric SEBBAG
|

|
|
 |
 |
|



