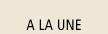

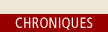
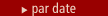
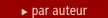

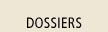
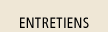
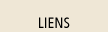
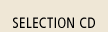
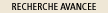

|
 |
|
CHRONIQUES
|
31 décembre 2025
|
 |
|
1987, année phare autant que fatidique pour l'opéra baroque français : grâce au succès phénoménal, inespéré pour certains, inattendu pour tous les autres, d'Atys, William Christie et ses Arts Florissants se voient pour ainsi dire attribuer le monopole scénique de Lully, partant de la tragédie lyrique, donc de Rameau, qu'ils se sont à peine vus disputer, et presque exclusivement en concert, par Marc Minkowski et ses Musiciens du Louvre.
Osons pourtant dire, sans pour autant diminuer leurs respectables mérites, que ceux-là , ainsi que quelques autres – Rousset, Niquet, Reyne –, tentant d'abord timidement, puis en empruntant des voies plus secrètes encore – Marais, Desmarest, Destouches –, de s'inscrire dans leur sillage, n'ont fait que cueillir les fleurs plantées dès 1903 par Vincent d'Indy, et surtout patiemment, et copieusement arrosées par John Eliot Gardiner.
Créant les Boréades, qu'il avait osé à Londres en concert dès 1975, dans la nuit aixoise, il y donna l'année suivante l'Hippolyte et Aricie le plus somptueusement distribué qui se pouvait imaginer, où même la voix immense de Jessye Norman se pliait à l'ornement le plus délicat, miracle dont il ne subsiste qu'une captation précieusement conservée, et heureusement accessible à la vidéothèque d'art lyrique et de danse d'Aix-en-Provence.
Mais depuis la résurrection de Scylla et Glaucus de Jean-Marie Leclair en 1986, quelques mois avant le tourbillon Atys donc, le silence, bien que personne n'ait su restituer à la tragédie lyrique cette évidence, ce naturel dont le chef britannique était prodigue, à tel point que son enregistrement des Boréades demeure plus qu'une référence, un modèle. Autant dire qu'après vingt ans passés à explorer Mozart, Gluck, Monteverdi, Berlioz, et même Verdi, son retour à Rameau était inespéré.
Un Campra d'une beauté quasi irréelle
Coup de théâtre ! Lorsque Laurent Bayle lui propose un Domaine privé à la Cité de la musique, Gardiner répond Rameau, comme par nécessité, illustrant le versant religieux par le motet In convertendo, que complétaient, lors du Concert spirituel du 14 février, les Quatre versets d'un motet de François Couperin, quelque peu malmenés par deux sopranos en deçà des exigences d'une intonation redoutable, et un Requiem de Campra d'une beauté quasi irréelle, n'étaient les insuffisances récurrentes des solistes, issus du Monteverdi Choir, d'une couleur toujours superlative.
Mais c'est évidemment dans Castor et Pollux, présenté dans la version de 1754, qui redora le blason de la tragédie lyrique en pleine Querelle des Bouffons, que Gardiner était le plus attendu. Bien que les English Baroque Soloists n'aient que peu en commun – deux violonistes et une altiste, pour être précis – avec l'orchestre qui recréa les Boréades, ils retrouvent d'emblée cette sonorité claire, mais ni précieuse, ni volatile, posée sur ossature rythmique solide, mais ni rigide, ni brutale, qui nous les ont tant fait regretter, avant de reconquérir, dans les attaques et les fusées, une virtuosité qui ne coule pas de source pour qui ne joue pas régulièrement cette musique.
Il est vrai que Gardiner connaît tous les ressorts de la tragédie lyrique, d'une approche organique toujours juste, tant dans ses choix de tempi que dans le dosage de la dynamique et des contrastes, introduits par suspensions du discours musical et non par à -coups, dès lors que pas un effet de manche ne tend à pallier l'absence de machines ou de chorégraphie, la musique de Rameau se suffisant à elle-même, et transcendant, jusque dans les divertissements, le modèle lullyste.
|
 |
|
|
Solistes de pâle figure
Sans déparer, le chant n'est malheureusement pas toujours à la hauteur de l'événement. Car si le Monteverdi Choir est tout bonnement spectaculaire de précision, de clarté, et de variété, les solistes qui en sont issus font pâle figure, que ce soit par défaut de timbre – le Jupiter de Matthew Brook, le Grand Prêtre de Samuel Evans –, de diction – la Suivante de Julia Doyle, l'Ombre qui plus est acide de Miriam Allan – ou d'aigu, en ce qui concerne l'Athlète de Tom Raskin, confronté à une partie de haute-contre certes redoutable, le Mercure de Marc Molomot tirant seul son épingle du jeu, par familiarité avec ce répertoire.
Timbre clairet de lumière ternie, déclamation maniériste, où les effets de voix blanche ou recouverte d'air semblent lui tenir lieu de palette expressive, la Télaïre de Sophie Daneman – que n'y a-t-on distribué Véronique Gens, plus encore que Sandrine Piau, initialement prévue – ne fait jamais le poids face à la Phébé de Jennifer Smith. La voix de la soprano britannique n'a certes jamais été belle, encore moins homogène, mais celle qui fut, il y a au moins vingt-cinq ans donc, de toutes les aventures ramistes de Gardiner – bouleversante Alphise – n'a rien perdu de son éloquence, surmontant le trac d'un retour inattendu pour dresser un portrait d'une vindicative fragilité.
Si la fréquentation d'autres répertoires a quelque peu amoindri la ductilité avec laquelle Laurent Naouri couvrait, il y a peu encore, les ambitus démesurés des grandes basses ramistes – il suffira de réécouter son Anténor d'anthologie dans un Dardanus qui ne l'est pas moins pour s'en persuader –, elle n'a en rien altéré son sens de la grandeur tragique.
À ce Pollux d'une authentique stature de demi-dieu répond le Castor éblouissant de jeunesse, et aux français immaculé d'Anders Dahlin. Encore un peu court dans le registre héroïque, le ténor suédois déploie aux Champs-Élysées une voix mixte à se damner, privilège des émissions naturellement hautes qui évitent au haute-contre à la française de sombrer dans l'artifice.
Il ne reste plus à espérer que cette remarquable réussite incitera John Eliot Gardiner à revenir souvent à Rameau, qu'il sert décidément mieux que quiconque.
14 février, Cité de la musique
François Couperin (1668-1733)
Quatre versets d'un motet (1703)
Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
In convertendo (1715)
André Campra (1660-1744)
Requiem (ca. 1695)
Julia Doyle, Katharine Fuge, Miriam Allan, sopranos
Marc Molomot, Nicholas Mulroy, ténors
Matthew Brook, Samuel Evans, basses
16 février, Salle Pleyel
Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Castor et Pollux, tragédie lyrique en cinq actes
Version révisée de 1754
Livret de Pierre-Joseph Bernard.
Anders Dahlin (Castor)
Laurent Naouri (Pollux)
Sophie Daneman (TĂ©laĂŻre)
Jennifer Smith (Phébé)
Julia Doyle (une suivante d'Hébé)
Miriam Allan (une ombre)
Katharine Fuge (Cléone)
Matthew Brook (Jupiter)
Tom Raskin (un athlète)
Marc Molomot (Mercure)
Nicholas Mulroy (un spartiate)
Samuel Evans (un Grand prĂŞtre).
Monteverdi Choir
English Baroque Soloists
direction : Sir John Eliot Gardiner
|
 |
|
|
|
 |
 |
|



