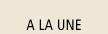

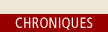
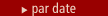
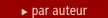

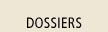
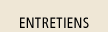
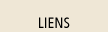
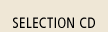
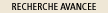

|
 |
|
CHRONIQUES
|
01 juillet 2025
|
 |
|
Certes, le Cercle de l'Harmonie joue sur instruments d'époque, mais l'ensemble fondé par le chef Jérémie Rhorer et le violoniste Julien Chauvin n'est pas une formation « baroque » – galvaudé, ce terme est à manier chaque jour avec davantage de précautions – pour autant. En reprenant le nom de l'orchestre fondé par le chevalier de Saint-Georges qui, né esclave en Guadeloupe, devint intime de la reine Marie-Antoinette, ces musiciens se sont en effet donnés pour mission de réhabiliter la musique tant lyrique que symphonique de la seconde moitié du XVIIIe siècle, écrasée par les figures tutélaires de Mozart, Haydn et Gluck, afin de mieux éclairer la période de transition, communément baptisée classique, entre les effluves galantes du dernier baroque et les bourrasques Sturm und Drang du romantisme naissant.
Avec Diana Damrau, le Cercle de l'Harmonie en a illustré le versant viennois à travers les Arie di bravura parues chez Virgin Classics. Au Théâtre des Champs-Élysées, la soprano allemande aura certes dû se contenter de l'Ensemble Orchestral de Paris – sans doute moins sémillant, mais placé sous la baguette toujours attentive à des phrasés aussi peu alanguis que possible avec une formation de ce type, notamment dans les ouvertures de la trilogie Da Ponte, de Joseph Swensen – pour défendre ce programme pour le moins ardu, malgré l'absence des airs aux ambitus les plus étendus, peut-être pour une question de diapason.
Si Mozart sort évidemment vainqueur de la confrontation avec Salieri, ce dernier démontre qu'il s'inscrit, à l'instar de Gluck, qui ne fut ni seul, ni précurseur parmi les réformateurs de l'opera seria, dans un courant qui allait façonner le cadre de l'opéra romantique, notamment à travers le bouleversement des formes, particulièrement par l'interpénétration des genres – les ensembles, réservés à l'opera buffa envahissent peu à peu le genre tragique –, et la mutation du rôle de l'orchestre.
|
 |
|
Sauts d'intervalles meurtriers

Encouragés par des prime donne aux ressources vocales surnaturelles – il est vrai que les carrières, débutées au crépuscule de l'adolescence, duraient rarement plus de quinze ans, et que l'homogénéisation des registres, passée dans les moeurs vocales depuis qu'un beau jour de 1837, le ténor Gilbert Louis Duprez émit son fameux ut de poitrine, ne les préoccupait guère –, les Traetta, Jommelli, Gluck première manière, Salieri, et bien évidemment Mozart composèrent des arie aux cascades de coloratures frisant la caricature jusque dans des sauts d'intervalles meurtriers, et qui pour cette raison même précipitèrent la fin d'un certain type de virtuosité vocale au profit de lignes où l'ornementation, moins spectaculaire, se voulait non plus démonstration de pure instrumentalité, mais servante de l'expression.
Sans doute Mozart a-t-il le mieux illustré cette transition dans la Flûte enchantée à travers les vocalités de la Reine de la Nuit et de Pamina. En novembre dernier au Metropolitan Opera de New York, Diana Damrau alterna les deux rôles pour ses adieux à la Reine de la Nuit. Il n'en reste pas moins que sa voix s'épanouit pour l'heure davantage dans l'écriture acrobatique des airs d'Alzima de Cublai, gran Khan dei Tartari, Semiramide de Salieri, et Giunia de Lucio Silla de Mozart que dans la bouleversante simplicité d'un Ach, ich fühl's supérieurement sensible, et pourtant comme effleuré sur la pointe des harmoniques.
Sans doute la voie de Diana Damrau est-elle toute tracée vers ces Zerbinetta, Gilda, Manon et autres Lucia qui font la gloire des coloratures à tempérament lyrique, mais cette facilité – celle-là même qui lui permet de chanter en bis un Alleluia de l'Exsultate, jubilate avec aussi pétillant que le Mein Herr Marquis d'Adèle dans la Chauve-souris de Johann Strauss – dans la vocalisation – suffisamment legata pour ne pas sembler martelée, mais assez détachée pour ne pas être savonnée – et le suraigu – jamais ostentatoire, serti dans la ligne comme la note de passage qu'il se doit d'être dans ce répertoire – serait indispensable à la redécouverte et à la défense d'un répertoire où s'époumonent le plus souvent des voix en tête d'épingle.
|
 |
|
Une déclamation coulée dans le marbre

Avec sa technique toujours empirique, ses prises de rôles imprévisibles, kamikazes et revendiquées comme telles, Mireille Delunsch est l'exact inverse de sa consoeur allemande. Et après une Elettra d'Idomeneo douloureuse à l'Opéra du Rhin, le programme composé par Jérémie Rhorer autour des premières héroïnes romantiques prenait des allures de test pour la reprise d'Iphigénie en Tauride au Palais Garnier, où la soprano française doit incarner le rôle-titre, dont elle livra au disque une interprétation de référence sous la direction de Marc Minkowski voici près de dix ans.
Dès les premières mesures du récitatif d'Iphigénie, Non, cet affreux devoir je ne puis le remplir, la voix de Mireille Delunsch se coule dans le marbre du récitatif gluckiste deuxième manière, où la déclamation, soutenue par de typiques effets de tremolo coulé, prend le pas sur la progression harmonique avec ce déchirant naturel, cette lumière, ces allégements de l'émission qui sont sa signature. Je t'implore et je tremble et Fortune ennemie !, extrait d'Orphée et Eurydice, dont la version italienne créée à Vienne en 1762 fut adaptée pour la scène parisienne en 1774, démontrent comment, dans la forme close que constitue l'air, Gluck prend également appui sur le texte, jouant pleinement des ruptures entre les registres vocaux en illustrant non plus une rhétorique des affects proprement baroque, mais les soubresauts de la sensibilité.
Quelques mois après la création d'Iphigénie en Tauride, Jean-Chrétien Bach, le fameux Bach de Londres que Mozart admirait tant, reprend Amadis de Philippe Quinault, mis en musique par Lully en 1684, comme Gluck l'avait fait avec Armide, où il adapte son style réformé au goût français, mêlé à une virtuosité encore italianisante. L'extrême classicisme mélodique des airs d'Oriane, À qui pourrais-je avoir recours et Ô spectacle effroyable !, n'en trahit pas moins la volonté d'un impact déclamatoire certain.
Luigi Cherubini marque un autre pas dans l'évolution de la forme lyrique. La version originale de Médée, qui sera reprise en avril prochain à la Monnaie de Bruxelles sous la direction de Christophe Rousset, appartient en effet au genre de l'opéra-comique, c'est-à -dire que les récitatifs n'y sont plus chantés, mais parlés. Dans l'air Du trouble affreux qui me dévore, Mireille Delunsch trouve, en dissociant les registres, un compromis idéal entre un chant sculptural et une déclamation émue.
Dans la Vestale (1807), Gaspare Spontini annonce déjà la cantilène bellinienne, et Toi que j'implore exige assurément une toute autre tenue de souffle et une plus grande malléabilité de la pâte vocale que celles dont la soprano française fait preuve. La redoutable strette qui suit trouve en revanche une pugnacité idoine dans le tranchant du timbre, tandis que dans l'air de Laméa Sans détourner les yeux, extrait des Bayadères de Charles Simon Catel, créées en 1810 par la même Alexandrine-Caroline Branchu qui fut la première Julia de la Vestale, Mireille Delunsch s'invente, sur un souffle frémissant, une tenue de ligne toujours et plus que jamais imprévisible.
Et si ceux-là mêmes qui réclamaient à cor et à cri le retour à la salle Favart des oeuvres qui en firent les heures de gloire trouvent désormais de bon ton, une fois entendu, de dénigrer Zampa, dont ce concert illustre les Rumeurs instaurées par le nouveau maître des lieux, Jérôme Deschamps, le Cercle de l'Harmonie démontre sous la direction de Jérémie Rhorer, qui décidément respire ce style, le talent, sinon le génie de Louis Joseph Ferdinand Hérold dans une deuxième symphonie évoquant, entre deux fanfares, ici Beethoven, là Schubert.
Concerts de Diana Damrau, accompagnée pour l'Ensemble Orchestral de Paris sous la direction de Joseph Swensen, Théâtre des Champs-Élysées, 18 mars 2008, et de Mireille Delunsch, accompagnée par le Cercle de l'Harmonie sous la direction de Jérémie Rhorer, Opéra-Comique, 20 mars 2008.
|
 |
|
|
|
 |
 |
|



