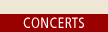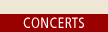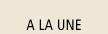

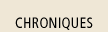
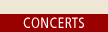
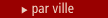
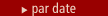
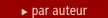
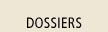
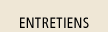
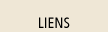
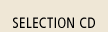
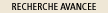

|
 |
| CRITIQUES DE CONCERTS |
30 décembre 2025 |
 |
Reprise de Così fan tutte de Mozart dans la production de Giorgio Strehler reprise par Gianpaolo Corti et sous la direction de Claus Peter Flor au Théâtre du Capitole, Toulouse.
Vibrant hommage
Confié à un metteur en scène moins soucieux de la lettre que de l'esprit de la dernière mise en scène de Giorgio Strehler, ce Così aurait pu être celui de tous les possibles. Il n'est reste pas moins un hommage exemplaire à l'art du metteur en scène disparu en 1997, servi par une distribution luxueuse, galvanisée par la direction de Claus Peter Flor.
|
 |
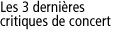
Surexpositions
Lady Macbeth en flammes
Retour vers le futur II
[ Tous les concerts ]
|
|
Art de l'éphémère, de l'étincelle de vie, de la magie de l'instant, le théâtre est de ceux qui ne laissent pas, ou peu de traces, et le plus souvent infidèles. Ainsi, vouloir conserver à tout prix des productions légendaires ne peut que les dénaturer, jusqu'à en ternir le souvenir : que reste-t-il en effet des Noces de Figaro de Giorgio Strehler, que la Scala s'apprête encore à reprendre, sinon un fabuleux écrin, perspectives éternelles d'Ezio Frigerio ?
Et que dire de ce Così fan tutte posthume que son inachèvement éloigne d'autant plus de son auteur que le metteur en scène italien fourmillait d'idées jusqu'à la générale, selon le témoignage de son fidèle décorateur, finalement bien plus précieux, à l'instar des notes de répétitions, que le joli spectacle sans vie présenté à Toulouse.

Un metteur en scène moins respectueux de la lettre du maître italien aurait sans doute pu réinjecter la sève nécessaire à sa renaissance. Ne restent ici que les témoins d'une esthétique, ombres limpides et valets de théâtre – auxquels Patrice Chéreau a rendu hommage dans son propre Così –, ce XVIIIe siècle réinventé, comme dénudé, où les corps, malheureusement réduits à la convention par Gianpaolo Corti, se frôlent sans ce désir qui sourd entre chacun des mots des notes de répétitions. La conclusion hâtive, surtout, où les couples se réconcilient sans trouble, ne peut être qu'un pâle reflet de l'art de Strehler.
C'est finalement dans la direction de Claus Peter Flor que la leçon du metteur en scène italien éclate dans tout sa vérité. Post-baroqueuse en diable, cette lecture aux arrêtes vives multiplie les contrastes dynamiques en tempi antagonistes, qui sans cesse relancent le flux musical et théâtral. Car le chef allemand n'exalte pas seulement jusqu'au sublime des adieux ce concerto pour orchestre et sextuor vocal, mais un théâtre des sentiments tourbillonnant de virtuosité, tout aussi exigeant pour les musiciens, dont la capacité de réaction est mise à rude épreuve, que pour les chanteurs, encore tributaires des alanguissements d'une tradition à laquelle le chef tourne résolument le dos, dans sa recherche du naturel et de la légèreté de l'articulation.
Les grandes voix dont Toulouse a le secret
Mais les qualités des grandes, jeunes et belles voix dont Toulouse a le secret, notamment le soin porté au phrasé – vertu rare, dans ce répertoire comme dans tous les autres – , excusent bien des décalages. Echappée d'un film muet, la Dorabella de Sophie Koch déploie son inépuisable velours avec une superbe fantaisie, un abattage souverain, la Fiordiligi de braise de Tamar Iveri captivant par la conduite éperdue de ses deux airs.
Si les graves de Guglielmo échappent souvent à Brett Polegato, il n'en a pas moins de panache scénique et de métal vocal, tandis que le Ferrando pataud de Tomislav Muzek déploie son format lyrique avec de superbes délicatesses, l'intonation et l'éclat de l'aigu parfois compromis par la fragilité de la zone de passage.
Enfin mutine, rusée, plutôt que mesquine et usée, exquisément chantante surtout, la Despina d'Anne-Catherine Gillet est tout simplement irrésistible, menant indéniablement le bal avec le Don Alfonso de Carlos Chausson, ni plus ni moins vétéran que les autres titulaires du rôle, mais dont la voix encore suffisamment malléable lui permet de ne pas sombrer dans ce parlando qui déséquilibre si souvent les ensembles.
Si elle n'avait été posthume, la rencontre entre Giorgio Strehler et Claus Peter Flor aurait pu donner naissance à un grand Così, jalon essentiel du théâtre mozartien. Il faudra se contenter de cet hommage musical, souvent exemplaire et ô combien vibrant, à l'art de l'homme de théâtre italien.
|  |  |
|
|  |  |
|