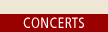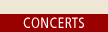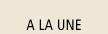

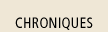
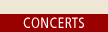
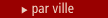
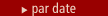
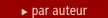
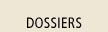
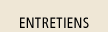
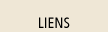
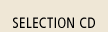
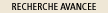

|
 |
| CRITIQUES DE CONCERTS |
21 décembre 2025 |
 |
Création française de Fin de Partie de Kurtág dans une mise en scène de Pierre Audi et sous la direction de Markus Stenz à l’Opéra national de Paris.
Ici le temps devient espace
L’opéra de Kurtág adaptant Fin de Partie de Beckett n’est sans doute pas pour un public élargi peu familier avec la pièce de théâtre. Même si la musique apporte une émotion inattendue et presque rayonnante, le corps de la pièce reste quand même attaché à l’immobilité et l’étalement du temps. Cette production exemplaire et exigeante atteint un sommet de musicalité.
|
 |
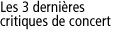
Lady Macbeth en flammes
États contradictoires
Les rĂŞves harmoniques des Diotima
[ Tous les concerts ]
|
|
Chaque adaptation à l’opéra d’une œuvre importante de la littérature nous apprend beaucoup sur les qualités et les limites du genre opératique. Les défis posés par la pièce de théâtre Fin de partie de Samuel Beckett ne sont pas minces. Plus que d’autres, Beckett avait compris qu’une grande part de la communication ne réside pas dans la parole, d’où un soin maniaque apporté aux didascalies, aux décors et aux indications de jeu pour les comédiens.
Si Beckett a clairement refusé toute musique de scène, il n’était pas fermé à une adaptation musicale de son œuvre. Toutefois, il imaginait plus une musique sans parole qu’un opéra. Car l’on sait que le jeu qu’il demandait à ses comédiens cherchait à donner aux mots leur propre valeur avec le moins d’interférence possible. Lui-même était un pianiste amateur fasciné par la musique romantique qu’il jouait de manière non-subjective !
En faisant œuvre lyrique, le compositeur György Kurtág a au contraire donné à certains mots une emphase singulière qui fait naître l’émotion. Tout amateur de l’univers de Beckett se retrouve alors dans une dimension inconnue. Un grand orchestre avec de très fines percussions apporte en revanche tout l’humour très noir appelé par le texte. Composée essentiellement d’accords d’une inventivité renversante, l’œuvre forme une musique de chambre comparable à l’art du dramaturge irlandais. Mais comme le temps ne s’écoule pas de la même manière à l’opéra qu’au théâtre, le compositeur a dû réaliser une adaptation du texte.
Amputée pourtant de près de moitié, la pièce dure à l’opéra plus longtemps qu’au théâtre. Si personne n’a renchérit avec Hamm lorsqu’il affirme « vous n’avez pas fini ? Vous n’allez donc jamais finir ? », c’est que peut-être le spectateur (pas plus que les personnages) ne recherche l’anéantissement annoncé. En tout cas, les coupes effectuées ont pour conséquence d’obscurcir les relations entre les deux personnages principaux. Tout le ressort domination-soumission en devient moins perceptible, c’est regrettable. Pour le reste le spectacle est exemplaire.
La mise en scène de Pierre Audi, visiblement familier du monde beckettien, trouve le bon climat et aide les chanteurs dans leur immobilité puisque seul Clov se meut, du reste d’une manière stylisée bien trouvée. Frode Olsen, qui se taille la part du lion, a énormément progressé dans la prononciation du français depuis la création de l’œuvre à Milan en 2008 dont on peut regarder la captation sur YouTube. Nonobstant sa chaise roulante, il fait de Hamm un personnage impressionnant. Sa stature évoque même un Wotan infirme.
Dans la fosse, Markus Stenz dirige avec une fluidité qu’il n’avait pas encore à la Scala. Il faut dire que les pupitres de l’Orchestre de l’Opéra rivalisent de beautés de timbres au point que les accords concluant l’opéra appellent au recommencement.
|  |  |
|
|  |  |
|