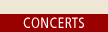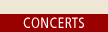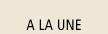

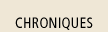
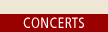
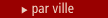
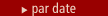
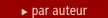
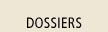
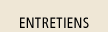
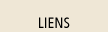
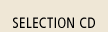
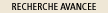

|
 |
| CRITIQUES DE CONCERTS |
27 janvier 2026 |
 |
Nouvelle production de Maria Stuarda de Donizetti dans une mise en scène d’Ulrich Rasche et sous la direction d’Antonello Manacorda au Festival de Salzbourg 2025.
Salzbourg 2025 (7) :
Tourner Ă en perdre la tĂŞte
Vision scénographique efficace d’Ulrich Rasche survolée par Lisette Oropesa pour cette Maria Stuarda de Donizetti au Festival de Salzbourg non exempte de quelques vertiges belcantistes. La pesanteur d’un théâtre répétitif et la direction molle d’Antonello Manacorda ne sont malheureusement pas transfigurées par une Philharmonie de Vienne pourtant en splendeur.
|
 |
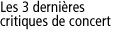
Surexpositions
Lady Macbeth en flammes
Retour vers le futur II
[ Tous les concerts ]
|
|
Maria Stuarda est une œuvre paradoxalement gluckiste : la concision de l’argument, l’absence de péripéties, de revirements des personnages, d’ailleurs en petit nombre (six), la rapprocheraient presque encore davantage de l’oratorio que l’Orphée de Gluck. Par ailleurs, il faut une bonne raison pour investir le vaste Großes Festspielhaus de Salzbourg pour un opéra de 1835.
Du coup, la conception d’Ulrich Rasche trouve à notre sens une forme d’évidence : son dispositif colossal requiert un espace immense, et la mise en scène reléguée derrière la scénographie se met au service de l’écoute de la musique avec une efficacité qu’on jugera au choix modeste ou prétentieuse. Le systématisme écrasant de deux plateaux tournants campe bien la situation de ces deux reines rivales prisonnières chacune de sa logique et incapables d’habiter le même espace – elles ne se seraient jamais rencontrées dans la vraie vie –, condamnées à ressasser sans fin la même logique.
Mais la marche permanente en rythme de tout le monde au plateau, tantôt en arrière, tantôt en avant, pas tant pour se déplacer que pour compenser la rotation du décor et rester à la face, est indiscutablement un facteur hypnotique de monotonie et de dissolution de l’action. D’autant qu’un manichéisme appuyé entre Thanatos (Elisabeth en noir et en menaces) et Éros (Marie en blanc et ses danseurs à demi nus) lisse les aspérités d’une situation historique complexe.
Contraste assez réussi, deux images d’Élisabeth sous pression de la foule des courtisans au début, laissée à l’absolue solitude du pouvoir après avoir signé l’acte de décapitation de sa cousine, ne compensent pas les limites de la distribution : si Kate Lindsey innerve le personnage d’une sombre présence incendiaire, la voix trop légère contrainte à une émission appuyée et aux voyelles vagues accuse ici un manque de rondeur dans le médium, là d’éclat dans l’aigu, et un style mastoc et concret.
Tout le contraire de la radieuse Marie Stuart de Lisette Oropesa, chant modelé et modulé, émission suspendue sur le souffle, moyens prodigieux d’ampleur, de longueur, de qualité. Laissons les esprits chagrins ergoter sur une voix de poitrine parfois déconnectée, ne retenons qu’une splendeur vocale et musicale poussée au plus haut niveau de soin.
Beau Roberto de Bekhzod Davronov, Talbot enrobant d’Aleksei Kulagin, Cecil non dépourvu d’éclat de Thomas Lehman, Anna vindicative de Nino Gotoshia, et une Philharmonie de Vienne de toute beauté, presque trop luxueuse pour une musique moins dévolue au sortilège qu’à l’efficacité dramatique : c’est là que le bât blesse, la direction rondouillarde d’Antonello Manacorda privant les chœurs de tout intérêt (inaudibles et en retard) tandis qu’une matière orchestrale non empoignée et dénuée de staccato ménage ici ou là des nuances infinitésimales enchanteresses.
Il aurait donc été possible d’entendre le chœur, mais pour cela il eût fallu que le chef renonçât à une assez complaisante symphonie de beaux timbres au profit de l’action, qu’il s’occupât du plateau et pas seulement de la fosse – avec peut-être pour bénéfice collatéral une meilleure synchronisation des deux.
|  |  |
|
|  |  |
|