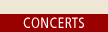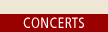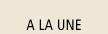

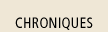
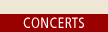
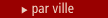
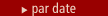
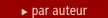
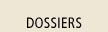
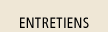
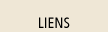
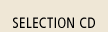
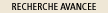

|
 |
| CRITIQUES DE CONCERTS |
12 juillet 2025 |
 |
Nouvelle production de la Finta Giardiniera de Mozart dans une mise en scène de Vincent Boussard et sous la direction d’Andreas Spering au festival d’Aix-en-Provence 2012.
Aix 2012 (1) :
Une fausse jardinière en décor naturel
Julian Prégardien (Belfiore)
Plus tout à fait opéra de jeunesse, mais pas encore chef-d’œuvre de la maturité, la Finta Giardiniera peut faire les frais d’une approche trop légère. Si Vincent Boussard succombe à la magie prodiguée par le coucher de soleil sur le domaine du Grand Saint-Jean, ses personnages se perdent dans la pénombre, illuminée par la Sandrina pulpeuse de Layla Claire.
|
 |
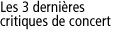
Les noces funèbres d’Orfeo
Elias à la gloire du chœur
Le prix de l’audace
[ Tous les concerts ]
|
|
Opéra de jeunesse encore, ou premier de la maturité ? Si la question ne se pose plus pour Idomeneo, la réponse dépend, dans le cas de la Finta Giardiniera, du traitement réservé par le chef d’orchestre et le metteur en scène à ce dramma giocoso à l’équilibre ambivalent. Paysagiste aguerri des passions baroques, Vincent Boussard peine néanmoins à débroussailler les allées de ce jardin sinueux.
Sans doute parce qu’en tombant sans un pli sur l’ouvrage, le décor naturel du domaine du Grand Saint-Jean s’avère une aubaine autant qu’un piège, qui plus est lorsque la nuit tombe sur le parc en même temps que sur les personnages. Dès que ces derniers se perdent entre les frondaisons – ici des roses artificielles – du discours amoureux mozartien, le metteur en scène les égare dans une agitation lassante – et des costumes pauvrement inspirés de la manière postmoderne de son complice Christian Lacroix –, chargeant une farce dont le Podestat, poussé jusqu’à la caricature hystérique, est le dindon.
La folie, qui dans le finale du II menace de se généraliser, et se prolonge, onirique, au III, souffre d’un manque d’organisation qui la rend anecdotique, alors même qu’elle est le point culminant du parcours initiatique de Sandrina et Belfiore, école des amants préfigurant Così fan tutte, comme l’avaient si bien montré les Herrmann dans leur mise en scène reprise la saison dernière à la Monnaie de Bruxelles.
Quelques trouvailles piquantes, comme ce tuyau d’arrosage métamorphosé en cor pour l’entrée de Belfiore, ou de jolies ombres projetées sur le mur du château ne suffisent pas à maintenir l’attention dans une œuvre qui, même amputée d’une demi-douzaine d’airs, semble s’éterniser – écueil récemment évité par des productions paradoxalement plus exhaustives.
La direction d’Andreas Spering, moins sèche que concentrée dans sa célérité, tend pourtant à éviter la dispersion du son et des intentions, défi dont la réussite confine un exploit dans une acoustique aussi soumise à l’empirisme que celle du Grand Saint-Jean. L’extraordinaire cohésion du Cercle de l’Harmonie, aux textures moins variées que sous la direction de Jérémie Rhorer, mais d’un semblable engagement, lui est assurément d’un grand secours. Davantage en tout cas qu’une distribution aux mérites inégaux.
Si le premier acte laisse découvrir un ensemble de voix finement conduites, sans rien qui les distingue, les suivants permettent aux uns de s’épanouir, tandis que les autres révèlent leurs limites. Celles d’Ana Maria Labin sont d’ordre expressif, Arminda au timbre crémeux mais d’une furia sans autodérision. À peine remise d’un refroidissement qui tasse son mezzo prometteur, Julie Robard-Gendre achoppe quant à elle sur le rythme, qui lui fait courir devant ou derrière les coloratures de Don Ramiro.
Constamment tourné en ridicule, le Podestat de Colin Balzer se réfugie dans des effets maniérés, accentués par une voix sans séduction – pour peu que Don Anchise en soit pourvu. Le ténor de Julian Prégardien affiche non sans verdeur l’attrait de la jeunesse, mais ce musicien élégant s’essouffle bien vite, limité par une technique insuffisamment aguerrie pour affronter tous les obstacles de la partie de Belfiore, constamment sur le fil de sentiments troubles.
La Serpetta de Sabine Devieilhe et le Nardo de John Chest forment en revanche un couple irrésistible ; elle, fine mouche, agile de timbre, léger, fluide, jamais volatil, comme de chant, espiègle et soigné ; lui, franc, fringant et délié. Mais la révélation de cette production de l’Académie européenne de musique est incontestablement Layla Claire, Sandrina à l’italien un peu raide encore, mais dont le soprano pulpeux ne cesse de s’épanouir pour illuminer une soirée trop souvent menacée par la pénombre.
|  |  |
|
|  |  |
|