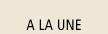

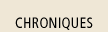

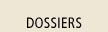

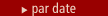
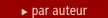
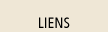
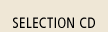
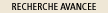

|
 |
| ENTRETIENS |
06 juillet 2025 |
 |
Pierre Boulez (I) : Bartók et Ravel
Pierre Boulez (II) : Les orchestres, Mahler, Bruckner
Pierre Boulez (III) : Bayreuth et Wagner
Pierre Boulez (IV) : Les grands projets
Vous allez diriger dans quelques semaines le Ch√Ęteau de Barbe-bleue de Bart√≥k et Daphnis et Chlo√© de Ravel avec l'Orchestre de Paris au Ch√Ętelet. Bart√≥k a-t-il particip√© au renouveau du langage musical du XXe si√®cle au m√™me titre que Schoenberg, Stravinski ou Debussy ?
Certainement, mais dans une cat√©gorie compl√®tement √† part, que je qualifierais de limitrophe. Une grande partie du renouveau de la musique √† cette √©poque est venue d'un courant un peu excentr√©. Chez Bart√≥k comme chez Stravinski, loin des pr√©occupations de la tradition d'Europe centrale initi√©e par l'√Čcole de Vienne de Schoenberg et ses disciples Berg et Webern, la r√©novation rythmique en particulier a √©t√© tr√®s influenc√©e par la musique populaire. Il existe des reproductions graphiques d'une minutie extraordinaire des notations de chants populaires que Bart√≥k avait r√©alis√©es, qui ont jou√© un r√īle important dans la r√©novation de sa propre musique et de son style. |
 |

|
|
Votre r√©pertoire compte relativement peu d'op√©ras, pourquoi y avoir inclus le Ch√Ęteau de Barbe-Bleue ?
Car il s'agit d'une oeuvre √©tonnante, d'une esp√®ce de ¬ę monodrame ¬Ľ √† deux personnages, assez curieusement √©crit √† la m√™me p√©riode qu'Erwartung de Schoenberg, qui lui est un v√©ritable monodrame, avec son √©trange histoire de femme √† la recherche d'un mort, qui ne sait plus distinguer le r√™ve de la r√©alit√©. Le Ch√Ęteau de Barbe-Bleue n'est pas un op√©ra r√©el ou m√™me po√©tique, il proc√®de du mythe, de la l√©gende, il a une signification profonde, d√©riv√©e de Wagner. √Ä partir de la seconde moiti√© du XIXe si√®cle, l'op√©ra qui utilise le mythe d√©rive d'ailleurs toujours de Wagner. Le style de Bart√≥k est encore en formation mais d√©j√† tr√®s personnel dans le Ch√Ęteau de Barbe-Bleue, m√™me s'il ne s'agit pas encore du style totalement abouti et plus aventureux du Mandarin merveilleux. |
 |

|
|
Pourquoi cet opéra est-il presque exclusivement donné en version de concert ?
Parce qu'il est tr√®s difficile √† mettre en sc√®ne. On conna√ģt l'existence des sept portes. Une fois qu'on a vu la premi√®re, la deuxi√®me, la troisi√®me, on sait bien qu'on va arriver jusqu'√† la septi√®me. Il faut que la force du mythe qui se cache derri√®re ces portes soit tellement pr√©gnante qu'on √©prouve une certaine surprise en d√©couvrant ce qu'elles cachent. Ce n'est pas la succession des portes qui est importante, mais la progression de la d√©couverte de soi, du royaume de Barbe-Bleue.
Il ne suffit pas de mettre les portes en zig-zag sur scène, comme je l'ai vu parfois. Il faut travailler sur la surprise et la transformation qu'elle suscite chez les personnages. Et cela reste très difficile à réaliser visuellement. Lorsqu'on joue l'opéra en version de concert, chacun peut y voir ce qu'il veut et la succession des portes est nettement moins importante. |
 |
|
|
L'√©cole de l'est, y compris au XXe si√®cle, produit souvent une musique visc√©rale o√Ļ l'√©nergie prime sur le soin dans la forme. Comment un chef aussi analytique que vous, qui privil√©gie l'√©l√©ment structurel, la nettet√© de la mise en place et de l'intonation, se positionne-t-il par rapport √† l'√Ęme slave ?
Slave ou pas, la musique exige une certaine rigueur d'interpr√©tation. Lorsqu'en tant que compositeur, je prends la peine de noter quelque chose, je ne le note pas pour rien. Et je tiens √† ce que mes combinaisons de timbres, mes combinaisons rythmiques s'entendent. √Ä rester toujours approximatif, on ne rend pas compte de la musique. En tant qu'interpr√®te, c'est la m√™me chose, et j'essaie d'√™tre aussi fid√®le que possible aux indications de la partition, √† ses subtilit√©s. Il est √©vident que la rigueur ne suffit pas, mais si l'on ne prend pas pour base l'exactitude, on ne transmet m√™me pas le texte tel qu'il a √©t√© √©crit. L'expression latente, qui g√ģt dans le texte, qui n'est pas encore r√©v√©l√©e, n√©cessite ce premier pas que constitue la rigueur. Ensuite, on peut inventer, modifier, gauchir au-del√† de l'exactitude. |
 |

|
|
Justement, au-del√† de l'exactitude, selon l'orchestre qui vous fait face, le r√©sultat peut √™tre tr√®s diff√©rent dans la m√™me oeuvre, comme cela a √©t√© le cas entre le Sacre du printemps que vous avez donn√© √† Lucerne avec les Berliner et celui du Ch√Ętelet avec le London Symphony.
Diriger est √† mon sens un art du dialogue, d'utiliser le mat√©riau qui vous est fourni. Les grands orchestres ont des personnalit√©s tr√®s fortes, surtout chez leurs solistes. Il est certain que quand le basson des Berliner Philharmoniker ou du LSO commence son solo introductif du Sacre du printemps, il a des id√©es sur ce qu'il joue. Vous ne pouvez pas les ignorer et ne vous r√©f√©rer qu'aux v√ītres. Vous √©coutez d'abord ce soliste, si ce qu'il propose vous pla√ģt, vous le laissez faire, si certaines choses vous plaisent moins, vous lui indiquez ce que vous pr√©f√©reriez.
Au début du Sacre, certains bassonistes tiennent les points d'orgue assez longtemps. Si l'on exagère ces points d'orgue, je trouve que la phrase se morcelle. Il peut m'arriver de demander moins de longueur, ou plus d'inégalité dans les points d'orgue, selon leur fonction dans la phrase. Ce sont des arrangements avec le soliste. Et ce qui est valable avec un soliste l'est aussi avec l'ensemble de l'orchestre. Si la sonorité globale n'est pas assez rêche, je demande plus de rudesse, et si elle l'est au contraire trop, je demande alors un son moins cassant. C'est finalement un accord entre soi-même et l'orchestre. |
 |

|
|
Daphnis et Chloé de Ravel vous semble-t-il refléter la richesse artistique initiée par les Ballets russes à Paris ?
Assur√©ment. Daphnis est l'un des grands succ√®s des Ballets russes, mais aussi l'un des ballets les plus d√©velopp√©s, avec ses cinquante minutes de musique, tout comme le premier ballet de Stravinski, l'Oiseau de feu, qui est aussi le plus long de tous ses grands ballets. Cette tradition remonte √† Tcha√Įkovski, au grand ballet narratif du XIXe si√®cle, fait de num√©ros.
J'aime donner Daphnis en concert, car autant quelqu'un comme Mahler √©largit la tradition symphonique au point de la faire √©clater, autant Stravinski et Ravel ont la contrainte d'une histoire √† raconter qui les oblige √† √©laborer une forme nouvelle. On trouve √©videmment encore des num√©ros dans la musique des Ballets russes, mais aussi beaucoup de num√©ros de jonction qui assurent la fluidit√© des encha√ģnements. Dans Jeux, Debussy aura √©galement, mais pour une pi√®ce d'une quinzaine de minutes seulement, ce d√©fi de trouver une forme descriptive mais qui peut se suffire √† elle-m√™me si l'on fait abstraction du programme. |
 |

|
|
Que retenez-vous de l'élément chorégraphique dans Daphnis ?
À ma grande honte, je n'ai jamais vu ce grand ballet dansé, même si dans le fond assez peu de chorégraphes s'y confrontent. On en donne souvent des extraits, on joue surtout la deuxième suite en concert, très brillante en effet, mais on manque alors les deux tiers de la pièce. On entend quelquefois les deux suites dans la même soirée, mais je pense qu'il vaut mieux jouer le ballet dans son intégralité, car il en vaut la peine. |
 |

|
|
On retient souvent de Ravel l'orchestrateur génial mais aussi parfois la séduction un peu facile de la musique.
Oui c'est séduisant, mais je n'ai rien contre la séduction à vrai dire, surtout quand elle est de ce niveau-là. En effet, l'instrumentation, les sonorités sont très belles, les accords sonnent magnifiquement mais ces seules qualités ne suffiraient pas. Il y a des auteurs qui sont séduisants mais dont on se passe fort bien. La musique de Ravel dépasse la séduction extérieure, on y trouve aussi une science. Si on voulait analyser Daphnis, ce qui n'a du reste jamais été fait, on verrait que c'est construit peut-être mieux que du Vincent d'Indy. Ravel n'est pas seulement une succession de moments séduisants. Daphnis est même d'une construction très sévère, sa substructure est extrêmement forte, et c'est pourquoi la séduction fait son effet. |
 |
|
|
Et dans une oeuvre comme le Boléro ?
Il y a surtout une esp√®ce d'hypnotisation par la r√©p√©tition, m√™me si ce n'est tout de m√™me pas l'oeuvre la plus convaincante de Ravel. Je l'ai dirig√©e je crois deux fois en vingt ans, et je dois reconna√ģtre que c'est un plaisir extraordinaire que de voir √† quel point la mont√©e de cette orchestration est admirablement con√ßue. Le mat√©riel n'est pas d'une richesse exceptionnelle, m√™me si le th√®me en lui-m√™me est plus complexe qu'on le croit, moins simpliste qu'on peut le percevoir √† la simple audition. Mais Daphnis est tout de m√™me une oeuvre infiniment sup√©rieure.
Pierre Boulez (I) : Bartók et Ravel
Pierre Boulez (II) : Les orchestres, Mahler, Bruckner
Pierre Boulez (III) : Bayreuth et Wagner
Pierre Boulez (IV) : Les grands projets |
 |

|
|



