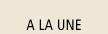

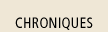

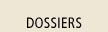

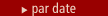
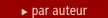
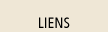
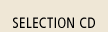
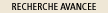

|
 |
| ENTRETIENS |
11 mai 2025 |
 |
|
Dans le calendrier mars-avril 2008 de l'Opéra de Paris, les Noces de Figaro mises en scène par Christoph Marthaler, vivement contestées lors de leur présentation en mars 2006 au Palais Garnier, sont annoncées par ces mots qui résonnent comme un manifeste : « Leur reprise au Théâtre des Amandiers de Nanterre […] devrait leur permettre de toucher un nouveau public, moins habitué des salles d'opéra. Et peut-être de trouver une autre compréhension et un autre accueil… »
Toute forme de spectacle, que ce soit un opéra ou une pièce de théâtre, doit être une interprétation. Une partition est l'expression d'une pensée musicale, et il est très étrange que les débats portent davantage sur la mise en scène que sur l'interprétation musicale. Nous savons par exemple, grâce à l'édition critique des oeuvres de Mozart, que certains signes ont souvent été mal interprétés. Dans le cas d'oeuvres aussi riches que celles de Mozart, ou Parsifal de Richard Wagner, différentes interprétations sont possibles, qui vont peut-être toutes toucher une partie de la vérité.
Lorsqu'on interprète une pièce aujourd'hui, on doit essayer de communiquer l'idée du compositeur. On doit donc partir, premièrement, du contexte de la création – quand Mozart ouvre un opéra avec des serviteurs en train de mesurer leur chambre pour savoir s'ils pourront y mettre leur lit, devant un public d'aristocrates habitués à voir des héros et des dieux, il crée un choc incroyable, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc que faire ? –, deuxièmement, de l'époque qui s'est apposée entre la création et aujourd'hui – le romantisme a souvent déformé le sens original des œuvres –, et troisièmement, de l'époque dans laquelle nous vivons – je dois transposer de telle façon que l'idée soit encore valable aujourd'hui.
Dans Wozzeck, la figure du soldat incarne l'échelon le plus bas de la société, ce qui n'est plus le cas – sauf peut-être pour certains soldats de l'armée américaine qui s'engagent parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres issues. Aujourd'hui, ce sont les sans-papiers, les sans-abri. Lorsqu'un critique ou un public réagissent, ils devraient d'abord se demander si leur idée sur la pièce correspond bien à celle du compositeur, ou s'il ne s'agit pas simplement de leur interprétation.
J'ai assisté à des répétitions des Noces de Figaro, et il est certain que dans le contexte du Théâtre de Nanterre, le décor est presque organique, alors qu'au Palais Garnier, il sautait aux yeux ; j'aime cela. Mais j'essaie maintenant de voir comment un public qui ne va pas normalement à l'opéra, qui n'est pas habitué à voir le Palais Garnier, va réagir. Je ne prétends pas que chaque mise en scène que nous avons créée était une réussite, mais je suis sûr qu'à chaque fois, nous faisons une recherche très précise. |
 |

|
|
Vous donnez le sentiment de ne pas vouloir faire de l'opéra pour la majorité du public actuel de l'Opéra, avec des exceptions comme la mise en scène très figurative de Cardillac proposée par André Engel.
Je cherche d'une part à intéresser le public existant à un nouveau répertoire, et d'autre part à le convaincre de regarder avec un autre œil celui qu'il connaît. Dans le cas de Cardillac, j'ai plutôt été sage dans mes choix. Si je l'avais monté en Allemagne, je l'aurais fait complètement différemment. Grâce à la mise en scène d'Engel, beaucoup de gens ont découvert la pièce, et nous avons eu encore douze mille spectateurs à la reprise, ce qui est énorme.
Je sens aussi que le public du Palais Garnier est un peu plus conservateur que celui de l'Opéra Bastille. Quand j'ai fait la Traviata avec Cambreling et Marthaler, tous les éléments du spectacle étaient parfaitement intégrés, ce qui n'était plus le cas à la reprise. Mais alors que Cambreling a été hué chaque soir, monsieur Oren a été acclamé, parce qu'il a dirigé dans la tradition italienne du XIXe siècle, qu'on croit être la bonne.
Je voulais vraiment faire cet essai « hors les murs » avec les Noces de Figaro. Je dispose d'un choeur issu de l'Atelier lyrique, qui est très investi, et d'un orchestre composé de lauréats du conservatoire, pour lesquels il s'agit d'une magnifique opportunité. Nous avons donc tout fait pour donner sa chance à cette mise en scène que je considère toujours très intéressante, car la démarche que nous avons faite, par exemple sur les récitatifs, est très sérieuse, et mérite d'être discutée. Marthaler ne joue pas simplement avec la pièce, mais avec les traditions qui s'y sont superposées.
Pour ce qui est du public, nous avons eu en 2007 les plus hautes ventes de ces dix dernières années à l'Opéra de Paris, avec un taux de remplissage de 94%, et ce malgré les mises en scène contestées et les œuvres modernes – sur quarante-six nouvelles productions, j'aurai fait découvrir une vingtaine de pièces du XXe siècle. Les choses fonctionnent donc, malgré toute la lutte, parfois très dure pour les artistes.
Je me demande parfois comment le récitativiste des Noces de Figaro, qui est un grand artiste, a tenu le coup jusqu'à la fin. Helene Schneiderman, qui a beaucoup de tempérament, m'a dit qu'elle n'avait jamais eu un trac aussi énorme qu'avant d'entrer en scène sous les huées pour chanter le grand air de Marcelline. On doit aller à la bataille, et c'est ce que nous allons faire maintenant à Nanterre. Nous avons invité des jeunes à qui nous avons montré une vidéo de la mise en scène de Günther Rennert à Salzbourg, dirigée par Karl Böhm, qui les a beaucoup fait rire, tant ils l'ont trouvée conventionnelle, puis la nôtre, dont ils ont ri parce qu'ils s'y sont vraiment investis.
Je reçois des lettres de spectateurs plus âgés qui me disent que l'opéra n'est pas simplement pour les jeunes, mais aussi pour eux. Et je constate que les personnes plus âgées sont divisées. Un monsieur vient de m'écrire à quel point il a été pris par Wozzeck, et que les larmes qu'il a versées n'avaient rien de sentimentales.
La force de Wozzeck réside justement dans l'impact direct d'un langage littéraire et d'une musique complètement artificiels – c'est ce qui le différencie du Tabarro de Puccini dont l'histoire est sensiblement la même –, et c'est ce que Cambreling et Marthaler ont montré, le premier en dégageant tous les thèmes pour faire entendre comment Berg reprend la tradition et la change, le second avec une mise en scène artificielle jusque dans ses moindres mouvements, même ceux qui paraissent les plus naturels. À la fin, quand Wozzeck a tué Marie, il jette les souliers qu'il a passé toute la pièce à mettre en ordre. C'est un geste magnifique pour quelqu'un qui regarde.
Marthaler est un très grand metteur en scène. Wozzeck marque notre dernière collaboration à Paris, mais nous sommes déjà en train de réfléchir pour New York, et nous voudrions étudier la musique américaine, en allant peut-être vers le Music Hall, pour raconter une histoire autour de l'émigré en Amérique. Et je voudrais faire Falstaff avec lui, encore un personnage qui n'est pas accepté par la société, comme Violetta et Wozzeck. |
 |

|
|
Vous reprenez fin mai une autre production très contestée à sa création, l'Iphigénie en Tauride signée Krzysztof Warlikowski. Pensez-vous qu'elle sera mieux acceptée, après l'Affaire Makropoulos et Parsifal ?
Cette fameuse soirée où quelqu'un a crié : « Mortier au bûcher ! » J'ai répondu : « Je serai la première Jeanne d'Arc de l'Opéra ! » Lorsque j'ai présenté ma saison l'année dernière, j'ai montré une vidéo de ce spectacle et des personnes ont encore hué en voyant cette vieille femme. Pourtant, au fil des représentations, les réactions positives l'avaient emporté, comme pour Parsifal d'ailleurs.
Évidemment, certaines personnes ont été choquées par l'accent que nous avons mis sur la vieillesse. Notre époque recule la vieillesse, on ne veut pas l'accepter. L'affiche représentant une vieille dame avait déjà beaucoup choqué. Mais j'aime les personnes âgées ; un visage vieux peut être très beau, on y voit toute une vie, c'est fascinant. Aujourd'hui, on nous montre toujours des jeunes gens lisses, parfois séduisants, mais souvent ennuyeux, et c'est d'abord ce que nous voulions raconter.
Iphigénie est une femme qui a vécu, qui a certainement quarante ou quarante-cinq ans dans l'opéra, et qui est obligée – quel métier ! – de tuer. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui est raconté dans cette pièce ! Donc je vais la reprendre. Je suis très curieux de la réaction du public, mais je crois qu'il sera plus facile de gagner avec Iphigénie qu'avec les Noces de Figaro, parce que ces dernières vont plus loin.
À l'entracte, une femme s'est retournée et m'a dit : « Ah ! toute cette laideur que vous amenez ! » Je suis flamand, et peut-être ai-je pour cette raison un sens pour un certain réalisme, alors que les latins ont plutôt tendance à vouloir tout idéaliser. Je ne méprise pas le public, je comprends qu'il ait d'autres idées, et j'essaie de le convaincre. Mais quand je reçois des lettres d'insultes, je réagis avec force, parce qu'on ne doit pas se laisser insulter par des personnes, venant souvent d'ailleurs du 16e arrondissement ou des banlieues chic de Paris, qui parce qu'elles achètent un tiers des places croient que l'opéra est leur propriété.
Lire la deuxième partie de l'entretien |
 |
|
|



