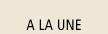

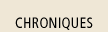

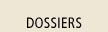

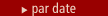
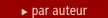
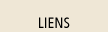
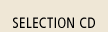
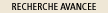

|
 |
| ENTRETIENS |
01 juillet 2025 |
 |
|
Vous avez chorégraphié beaucoup de symphonies de Mahler. Quelle est la place particulière de la 3e dans votre œuvre ?
C’est effectivement un ballet qui a une place spéciale dans ma carrière et même dans ma vie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je suis heureux de pouvoir le donner au Ballet de l’Opéra avec qui je suis déjà lié par une longue et belle histoire. Tout a commencé au moment de la mort de John Cranko. On m’a demandé de faire une pièce pour un gala à sa mémoire. Le texte du quatrième mouvement, sorte de méditation inspirée par la mort, m’a semblé très adapté.
Mais en écoutant toute la symphonie, j’ai ressenti également l’envie de la chorégraphier en entier. C’était au début de ma carrière et je cherchais à m’orienter aussi vers des ballets d’une soirée entière mais non narratifs, en trouvant une structure, un fil conducteur, subjectivement, en fonction de mes réactions sur la musique seule, sans raconter une histoire. Je voulais travailler uniquement sur l’émotion que la musique éveillait en moi. Ce fut pour moi un travail très dense, très dur. Je n’y ai d’ailleurs rien changé depuis et j’ai tous les pas en mémoire. |
 |

|
|
C’est une œuvre qui a à la fois une grande unité de pensée et une vraie diversité dans l’esprit de chaque mouvement. Comment avez-vous géré cette particularité ?
Au départ, comme solution, j’avais envisagé de faire chaque mouvement avec une Étoile différente. Je pensais à Noureev pour le premier mouvement et à Violette Verdy pour le second, car elle m’inspire beaucoup. Mais ce fut irréalisable pour des questions d’emploi du temps. Quand j’ai créé le quatrième mouvement pour le gala à la mémoire de Cranko, je l’ai fait pour trois Étoiles du Ballet de Stuttgart qui était sa compagnie : Marcia Haydée, Richard Cragun et Egon Madsen.
Dans le contexte dramatique de la compagnie qui venait de perdre brutalement son directeur, mort d’une crise cardiaque dans l’avion qui les ramenait d’une tournée et qui n‘avait pu atterrir à temps à cause du mauvais temps, j’imaginais que ces trois danseurs commençaient par se livrer à une réflexion sur la mort et songeaient à quitter la danse, mais que se retrouvant sur scène, ils reprenaient ensemble leurs forces et décidaient de continuer à pratiquer leur art.
Quand je me suis mis à faire toute la symphonie, j’ai en fin de compte décidé que l’axe central serait toute la compagnie et non tel ou tel danseur particulier. C’est cela qui a donné son unité à l’ensemble. Mais j’ai gardé la structure originale du quatrième mouvement pour trois solistes. C’est seulement devenu un moment spécial dans un tout dont l’acteur central est la compagnie. C’est pourquoi d’ailleurs il y a beaucoup d’interventions individuelles, ce qui permet à un grand nombre de danseurs, Étoiles ou pas, de s’exprimer. |
 |

|
|
Il y a pourtant une gradation dans cette musique. On part de ce qui est presque une évocation concrète de la nature pour passer par la tragédie humaine du quatrième mouvement puis par un cinquième mouvement plus spirituel avec ce chœur des anges.
Cette gradation existe bien, mais elle est organisée autour de ce que ressent Mahler lui-même. C’est l’homme Mahler qui est au cœur de toute cette progression et c’est vraiment moi qui suis au cœur du ballet, dans mon rapport personnel avec cette musique. Même le cinquième mouvement n’est pas vraiment une évocation habituelle du ciel. C’est lui qui est présent partout de manière très concrète.
Je ne trouve pas du tout cela chez Bruckner, que je serais incapable de chorégraphier. Chez Mahler, on peut s’appuyer sur des Ländler, sur des marches. Il y a une séduction très concrète qui vous entraîne dans son univers, dans son imaginaire. Je pense que la danse, qui est le langage du corps, est parfaitement adaptée à ce type de propos, à la fois concret et abstrait.
J’étais d’ailleurs si enthousiaste à cette époque, quand j’étais jeune, que je voulais chorégraphier toutes les symphonies de Mahler. Ensuite, j’ai pris une distance, j’ai fait d’autres choses, et j’ai attendu que Mahler m’appelle, en fonction de mon évolution personnelle. À l’époque de la création, en 1975, tout ce que comporte la chorégraphie, je pouvais le faire, tous les portés, tous les pas. C’est peut-être parce que c’est si proche de moi que je n’ai jamais rien changé, alors que parfois, pour d’autres œuvres, il m’arrive d’adapter à tel ou tel interprète. |
 |
|
|
Trouvez-vous que les danseurs de la nouvelle génération, notamment ceux de l’Opéra de Paris, entrent facilement dans cet univers émotionnel et chorégraphique ?
Ils sont très intéressés par cette expérience. Je trouve les jeunes danseurs très ouverts. Techniquement, le ballet est très difficile et ils aiment ce genre de défi. En outre, ils sont habitués à mon travail qui est inscrit dans leur corps. |
 |
|
|
Vous avez chorégraphié les 1re, 3e, 4e, 5e, 6e, 9e et 10e symphonies de Mahler. Allez-vous aussi vous tourner vers les autres ?
Je ne sais pas. Après les deux dernières, il n’y a peut-être plus rien à dire. Et puis, la 2e et la 8e sont très difficiles à réaliser à cause des effectifs musicaux nécessaires. C’est impossible dans un contexte normal. Il faudrait que ce soit par exemple au festival de Salzbourg, pour avoir un lieu et un nombre de musiciens immenses. Mais à mon âge, je crois de toutes façons qu’il vaut mieux que j’attende que Mahler m’appelle encore. Quand il le voudra, je le ferai.
À voir :
Troisième symphonie de Mahler, du 13 mars au 11 avril à l’Opéra Bastille |
 |

|
|



