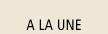

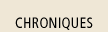

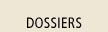

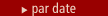
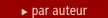
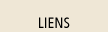
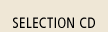
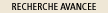

|
 |
| ENTRETIENS |
07 juillet 2025 |
 |
|
Toulousain, vous avez travaillé dans l’Orchestre du Capitole. Que vous a apporté Michel Plasson ?
Depuis que je suis né, je l’ai toujours vu chef du Capitole. Il a eu de l’influence sur moi depuis mes débuts de musicien. Il m’a apporté énormément, une façon de lire la musique au-delà des signes écrits et une recherche constante des couleurs, des idées, des images ainsi que de la mise en relief passionnée de petits détails. Ma formation a ensuite porté sur un répertoire symphonique germanique complété par ce travail de Michel Plasson. |
 |

|
|
Vous a-t-il communiqué sa passion pour la musique française ?
Absolument. Il a fait redécouvrir des partitions mal connues parce que mal jouées. Cela ne le rebutait pas. C’était un défi qu’il a gagné, notamment avec l’intégrale des symphonies de Darius Milhaud. Pendant mon séjour de six ans à l’Orchestre de Toulouse, nous avons enregistré vingt-six disques, presque uniquement de musique française. À chaque fois, il prenait la partition à bras le corps en disant que c’était aussi important que la 1re symphonie de Brahms pour Karajan.
Le résultat était frappant. Cela redonnait envie de réécouter la pièce et de la rejouer. Quand j’ai commencé ma vie de musicien, comme la plupart des adolescents, je n‘étais pas passionné par l’opéra, encore moins par l’opéra français que je voyais surchargé d’un sentimentalisme redondant. Plus tard, c’est devenu le contraire. |
 |

|
|
Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ?
Werther, par Alfredo Kraus. À l’occasion de mon premier voyage à Paris pour me présenter au conservatoire, j’avais 19 ans, et les amis qui m’accueillaient possédaient une télé et, un après-midi – cela n’arrive plus aujourd’hui –, il y avait Alfredo Kraus qui chantait Werther. Pour la première fois, je suis resté scotché devant ce monsieur qui chantait, comprenait, faisait comprendre, expliquait aussi aisément toute la partition. Un monde nouveau s’ouvrait à moi. À partir de ce moment là , je suis devenu un pur passionné d’opéra. |
 |
|
|
Vous êtes clarinettiste à l’origine.
J’ai commencé la musique très tard, à 16 ans, dans une petite école d’une cité à vingt-cinq kilomètres au sud de Toulouse. Comme j’étais l’un des plus doués et des plus intéressés, on m’a demandé de m’occuper des petits, d’orchestrer des partitions et de les diriger. La musique a toujours été pour moi très réactive quand il s’agissait d’écouter, de jouer, d’apprendre, de respirer.
Je suis sorti de l’orchestre. La clarinette est un pur hasard. Quand je suis arrivé dans le village, j’avais envie de jouer du violon ou de la trompette. On souhaitait une clarinette réclamée par l’harmonie municipale. J’ai pris la clarinette parce que cela se présentait ainsi et parce qu’avant tout, je souhaitais faire de la musique. La clarinette a été un beau cadeau. |
 |

|
|
Comment et pourquoi vous êtes-vous dirigé vers la musique ?
J’ai passé mon bac et j‘étais parti pour suivre des études d’ingénieur. J’ai eu un jour comme une illumination. J’ai su que je voulais la musique. J’ai dans le même temps appris que mon grand-père – nous sommes d’origine italienne – avait travaillé comme employé à la Scala de Milan. Je l’ai vu pleurer quand j’ai joué le Va pensiero du Nabucco de Verdi. Ce jour-là , il m’a dit qu’il allait me raconter ce qu’il avait vu. |
 |

|
|
Comment êtes-vous devenu chef d’orchestre ?
J’ai commencé par diriger, en partant de Toulouse en 1996, une opérette à Castres. C’était la Fille de Madame Angot de Charles Le Coq. Cela s‘est bien passé. On m’a demandé de revenir. Les choses se sont enchaînées. Je me suis mis à bosser. Le chef qui m’a alors influencé est Armin Jordan. Son charisme, son humanisme et son envie d’aider les autres m’ont fasciné : une rencontre superbe. Il m’a beaucoup marqué dans son amour de la musique, des gens, des rapports humains. Il nous a laissé un fils qui va devenir, la saison prochaine, directeur musical de l’Opéra de Paris. |
 |

|
|
Mais vous, comment êtes-vous devenu chef, surtout à l’Opéra de Paris ?
Avec ma clarinette, dans les postes précédents, j’ai été apprécié comme quelqu’un qui jouait bien. À la suite, j’ai estimé qu’on pourrait me confier des choses importantes. Sans doute les directeurs ont-ils su que je n’étais pas mauvais ? Et voilà , c’est arrivé. Avant ce Werther, j’ai dirigé vingt-sept opéras italiens comme Madame Butterfly ou Don Carlo. J‘ai dirigé non pas des orchestres prestigieux mais des musiciens remarquables. Il faut tout voir et tout apprendre dans des conditions techniques parfois difficiles depuis la lumière, les chœurs, les partitions.
J’ai eu la chance de bénéficier de conditions privilégiées où l’on peut créer. Aujourd’hui, je suis chef associé de l’Orchestre national de Lyon sous la direction de l’Allemand Jun Märkl. Jusqu’à cette année, j’étais chef d’orchestre à mi-temps. J’ai joué comme clarinettiste à l’Orchestre national de l’Opéra jusqu’à la fin décembre puis Gerard Mortier, directeur de la maison, a estimé qu’il pouvait me faire confiance. Ce n’est pas rien. J’ai dirigé en tant que chef les chanteurs de l’Atelier lyrique. Ce qui m’a stupéfait, c’est à quel point ces interprètes se trouvent impliqué lors d’un programme. |
 |

|
|
Vous allez diriger trois représentations de votre opéra fétiche, Werther.
Le retour de mon coup de foudre de jeune homme et mon premier choc d’opéra. Récemment j’ai dirigé à Dijon Eugène Oneguine de Tchaïkovski Je suis frappé par les correspondances et les interactions entre cette œuvre et les Werther, celui de Goethe et celui de Massenet. Là encore surgit un monde d’interrogations, d’indécisions magistrales et subtiles qui ne donnent pas de solutions, pas de décisions mais un monde qui est lié au texte, à la langue et au discours, à la phraséologie : une magie d'écriture musicale de la musique française. |
 |

|
|
Le chef principal de Werther est Kent Nagano. Comment vous entendez-vous avec lui ?
Je n’aurais pas accepté de travailler avec lui si je ne l’avais pas apprécié. J’avais aimé son approche très claire, très décisive des Dialogues des carmélites de Poulenc. J’ai souhaité diriger Werther dans sa suite, sans hiatus et dans un même respect d’une partition que l’on boursoufle et déforme si souvent. Nagano la rend claire et lisible. |
 |

|
|
On dit souvent que le français n‘est pas une langue musicale. Qu’en pensez-vous ?
Le français est une langue merveilleuse pour le théâtre ! Werther, c’est du théâtre. Massenet a voulu poser de la musique sur du théâtre. Il y a des phrases parlées sur de la musique. Werther est un des piliers de l’opéra français qui demande de grandes voix comme Susan Graham et Ludovic Tézier, qui chante la version pour baryton : une découverte et une surprise qui change la couleur de l’opéra. Elle est alors beaucoup plus sombre, plus hallucinée et plus proche de Goethe. |
 |

|
|
Comment cela se passe-t-il avec vos camarades de l’Opéra ?
J’ai joué dans beaucoup d’orchestres. Celui-là , je le connais. Facile ? Cela ne l’est jamais. Il y a toujours une défiance notoire à l’encontre du chef quel qu’il soit et peut-être plus encore s’il est instrumentiste. Après, voilà . C’est un superbe orchestre, qui peut jouer magistralement bien, que je connais bien. Ce qui m’intéresse, c’est ce que j’entends. Pour cela, il faut un certain climat afin de l’obtenir en aidant les musiciens à jouer. On ne naît pas chef d’orchestre, avec une auréole. Ce n’est pas un emploi simple. |
 |

|
|
Qu’est-ce qui dans l’avenir vous intéresserait le plus ?
Un théâtre pour faire avancer les choses, c’est-à -dire la création tous azimuts avec un rêve, celui de musicien du Siècle des lumières, sans spécialisation, dirigeant et créant des œuvres nouvelles et construisant une vie plus qu’une carrière. Ce que je voudrais c’est garder un pied dans un théâtre et un autre dans un orchestre : on ne peut se passer d’une symphonie de Mozart. |
 |
|
|
Quelles sont les Å“uvres que vous aimeriez le plus diriger ?
Le répertoire italien, mais ma formation est autour de Mozart et de la musique allemande, Beethoven et Schubert. J’adore Richard Strauss, Wagner, Prokofiev. Je n’ai aucune prétention de compositeur. J’écris pour les enfants et les étudiants afin de les faire progresser. Ma vocation est d’être chef d’orchestre. Et en plus musicien : la clarinette, on me l’a mise dans les mains. Ce que j’aime, c’est qu’elle a tendance à changer de couleurs, de nuances, de style. Elle peut faire de la musique baroque, ancienne, contemporaine. Elle est très proche d’une voix de soprano : on peut faire passer toutes les expressions.
À voir :
Werther, Opéra Bastille, les 22, 24 et 26 mars. |
 |

|
|



