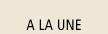

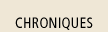

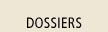

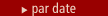
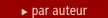
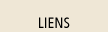
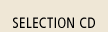
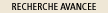

|
 |
| ENTRETIENS |
09 juillet 2025 |
 |
Vous venez de réenregistrer la Passion selon St-Matthieu de Bach, pourquoi ?
Une des raisons est que j'ai √©t√© en mesure d'enregistrer la seconde dans les conditions du direct mais sans public, alors que pour la premi√®re, des contraintes √©conomiques nous ont oblig√©s √† ne pas respecter la continuit√© de l'oeuvre. On a par exemple fait tous les chorals les uns apr√®s les autres, et je trouve que cela s'entend. C'est comme si on filmait une pi√®ce de th√©√Ętre en prenant toutes les r√©pliques d'un personnage les unes apr√®s les autres, comme cela se fait au cin√©ma. Or, un rapport de tempo s'√©tablit naturellement dans la continuit√© et dispara√ģt avec le morcellement des pi√®ces. La deuxi√®me St Matthieu a √©t√© donc saisie dans la continuit√© et l'on a fait les raccords apr√®s.
Une autre raison de la réenregistrer est que nous avons tous accompli des progrès, instrumentalement et vocalement.
Une troisi√®me r√©side dans le plateau. Avoir Rubens, Bostridge, Scholl, G√ľra et Henschel par hasard disponibles en m√™me temps cette ann√©e √©tait une occasion √† ne pas manquer. Or tous les chanteurs de cette distribution sont pay√©s sept fois moins qu'√† l'op√©ra. S'ils ont envie d'avoir une belle piscine, ils ne font plus cela. Or je ne sais pas qu'elle est leur priorit√© dans la vie, la musique ou la piscine ! Bien s√Ľr, j'exag√®re car il existe aussi un r√©el amour de l'op√©ra, mais on ne peut pas n√©gliger non plus la taille de piscine ! |
 |

|
Glenn Gould a soutenu que le montage dans les enregistrements pouvait devenir un acte créatif en lui-même. Considérez-vous le disque comme une photographie d'un moment ou l'aboutissement d'une construction, d'un projet ?
Idéalement, le but d'un enregistrement devrait être la fabrication d'un objet parfait, mais il y a une contradiction car cette perfection appelle un certain degré de répétition -plusieurs prises- qui détruit l'élan, la spontanéité. Comme tous les musiciens, je voudrais réussir à concilier les deux, c'est-à-dire que les concerts soient tellement parfaits que dans l'élan du moment, il puisse être enregistré sans rupture. Même si ma Missa Solesmnis n'a pas toujours été appréciée de la critique, j'en suis fier, car elle devait être enregistrée en deux concerts, mais le premier ayant été raté, seul le second a servi pour sa gravure.
Cela dit, je ne doute pas que fabriquer un objet parfait √† travers la r√©p√©tition comme Glenn Gould constitue en soi un processus artistique. Mais Gould faisant du Bach, c'est un peu de Bach et beaucoup de Gould. √Ä mon avis, Bach serait d'ailleurs tr√®s surpris s'il pouvait lire des √©crits de Gould et d√©couvrir sa conception de la vie o√Ļ la perfection formelle grav√©e prend une telle importance. Son d√©sir d'absolu, de puret√© et de propret√© dit peu sur Bach mais beaucoup sur Gould et l'√©poque dans laquelle il vit, celle o√Ļ les valeurs foutent le camp.
Pour Gould comme pour moi d'ailleurs, toute cette musique est construite sur des valeurs qui n'existent plus, dont il ne reste que la superstructure, la coquille vide. Cela crée une angoisse par rapport à laquelle on a envie de perfection. Gould et toute sa névrose en disent plus sur cette angoisse-là que sur les partitions, d'ailleurs toutes les périodes décadentes sont très préoccupées par la forme. Il y a là-dedans une espèce de morbidité qui est forte et admirable mais ce n'est pas du tout mon idéal artistique. Mon rêve, c'est le concert parfait et je pense aux artisans d'autrefois qui pour atteindre la perfection du geste se préparaient par une ascèse drastique en répétant inlassablement les mêmes mouvements. |
 |

|
Avez-vous l'impression que nous vivons une époque décadente, sur le plan musical comme sur un plan plus général ?
Vaste débat. Musicalement en tout cas, non. À mon avis le XXe siècle foisonne de génies comme Ligeti ou Kurtag.
Sur un plan plus général, je ne pense pas non plus. Les progrès scientifiques ne sont tout de même pas négligeables. Les progrès moraux existent, les droits de l'homme par exemple.
|
 |
|
On sait peu que vous avez été claveciniste autrefois, que vous en reste-t-il ?
J'ai certes pris quelques cours avec Scott Ross mais on ne peut pas dire que j'ai √©t√© claveciniste car je n'ai jamais donn√© de concerts. J'ai en revanche beaucoup appris en accordant un clavecin et j'ai surtout rencontr√© des gens fantastiques qui m'ont beaucoup appris sur le style. Mais √† c√īt√© du clavecin, j'ai aussi travaill√© l'orgue, le basson, le piano, le chant et accessoirement, j'ai accompli de longues √©tudes de psychiatrie, bref j'ai tout √©tudi√© sauf le m√©tier que je pratique, √† savoir la direction d'orchestre ! |
 |

|
Justement comment réglez-vous votre gestique en tant que chef ?
Je suis complètement autodidacte et je regrette d'avoir pris si peu de leçons. Il y a toute une technicité, des trucs que j'aurai sans doute découverts plus vite avec un professeur qui m'aurait transmis son expérience ; apprendre à faire une levée parfaite par exemple. Cela dit, cette technicité n'est pas essentielle à la musique. Par exemple Frans Bruggen -il le dit lui-même- n'est pas un modèle de technicité, mais il a sans doute dirigé les meilleures symphonies de Haydn qui soient. Une grande technicité de direction est nécessaire pour un opéra de Strauss, mais pas pour Haydn. Dans la Matthieu, un minimum de technique est nécessaire pour que l'orchestre soit ensemble, mais ce n'est pas l'essentiel de ce que j'ai à donner. Pour le Sacre du printemps, une mauvaise technique devient un obstacle car les exigences ne permettent pas toujours aux musiciens de s'entendre. Pour ma part, je pense pouvoir diriger Bruckner car sa musique n'est pas très complexe rythmiquement. Je ne serai sans doute jamais le chef rêvé pour le Sacre mais ce n'est pas grave car j'ai bien d'autres préoccupations. |
 |

|
À vos débuts, vous déclariez avoir une préférence pour les musiques architecturales, est-ce encore le cas aujourd'hui ?
J'ai de tr√®s bons souvenirs d'avoir c√ītoy√© Lassus, Josquin, Schein, Scheidt, Bach ; beaucoup de musique germanique o√Ļ la structure pr√©domine. √Ä l'oppos√©, il y a par exemple la musique fran√ßaise qui peut-√™tre fantastique, mais qui est quand m√™me beaucoup plus une musique de couleurs. Or je suis Flamand, donc plut√īt germanique et mes g√™nes me portent plut√īt vers cela. Quand j'√©coute Puccini, c'est bouleversant mais ce n'est pas mon univers. Dans la musique occidentale, il y a toujours une opposition entre le c√īt√© Appolinien et Dyonisiaque, entre les principes masculin et f√©minin, entre l'√©motionnel et l'immat√©riel. Pour moi, les plus grands compositeurs sont ceux qui arrivent √† r√©unir les deux. |
 |

|
Aujourd'hui, vous avez un peu délaissé le répertoire de la Renaissance, pourquoi ?
Je passe pour un sp√©cialiste du Baroque, mais si l'on consid√®re l'√Ęge Baroque, je trouve que c'est une p√©riode finalement assez pauvre. Si l'on cherche les g√©ants du XVIIIe si√®cle, il y a Bach, peut-√™tre Rameau et c'est tout. Et encore, je pense que si Rameau avait v√©cu √† Vienne en 1910, il aurait pu donner le meilleur de son inspiration.
Il y a aussi sans doute Monteverdi mais il a un bon pied dans la Renaissance. Or cette p√©riode en musique comme en litt√©rature ou en peinture est peut-√™tre la p√©riode la plus riche. Pour moi, on peut mettre Ockeghem √† c√īt√© de Beethoven, Josquin √† c√īt√© de Brahms. J'ai fait une vingtaine de disques dans ce r√©pertoire mais mon travail √©tait largement intuitif. Aujourd'hui, il y a des sp√©cialistes comme Paul Van Nevel ou Pedro Memelsdorff qui √©tudient toute la culture contemporaine des compositeurs. Je n'en ai plus le temps car j'ai envie de tenter la grande aventure du r√©pertoire Romantique et cela mobilise tout mon temps.
|
 |

|
À la suite du Baroque, on avait prédit un raz-de-marée du répertoire Renaissance, mais celui-ci tarde à se produire. Pourquoi à votre avis ?
Je conçois au moins deux raisons à cela. En premier lieu, les excellents ensembles en baroque étaient le résultat d'une évolution lente que le public n'a pas toujours perçue, avant Leonhardt, il y a eu Thurston Dart.
Ensuite, la musique baroque a connu un succ√®s populaire pour des raisons que je trouve n√©gatives. Le Baroque correspond √† la premi√®re p√©riode dans l'histoire de l'Occident o√Ļ la musique savante n'√©tait plus destin√©e aux √©lites -√©glise, aristocratie- mais au peuple. √Ä Venise, il y a eu jusqu'√† douze salles d'op√©ras dont le fonctionnement √©conomique d√©pendait du remplissage des si√®ges, donc il fallait s√©duire un public de moins en moins cultiv√©. Rythmes excitants, harmonies simples, messages clairs. Tandis que la musique Renaissance est une musique de Cour ou d'√©glise, tr√®s raffin√©e, et qui pour √™tre pleinement appr√©ci√©e demande de l'auditeur une formation, ne serait-ce que livresque.
Quelque part, la musique baroque est déjà en soi une musique populaire. Je pense donc que le raz-de-marée, s'il survient un jour, ne sera jamais de la même ampleur. Aujourd'hui dans les boutiques à la mode de Paris, on peut entendre Gérard Lesne en musique de fond, ça ne gêne pas trop. En revanche, des Madrigaux de Gesualdo, les derniers quatuors de Beethoven ou le Pierrot Lunaire, on peut toujours attendre !
|
 |

|
√Ä une √©poque, on a eu l'impression qu'il existait une sorte de pont entre le public de la musique baroque et celui de la musique contemporaine. Est-ce ce genre de pont que vous voulez reb√Ętir avec la programmation du festival de Saintes qui m√©lange les deux cette ann√©e, et dont vous √™tes le directeur artistique ?
Le pont existait surtout, je pense, pour les artistes eux-mêmes. Les frères Kuijken par exemple sont des artistes sincères et curieux. Dans le public en revanche, je pense que rares sont ceux qui aiment à la fois Ligeti et Charpentier. À Saintes, très modestement, car ce n'est qu'un petit festival, ce qui lie les gens est une espèce de "religion" d'aimer les belles choses, de faire certains choix dans la vie. Ce partage de la beauté, c'est d'abord une communauté physique, le plaisir d'être ensemble et de tenter de nouvelles expériences. |
 |

|
Mais pour un certain public, la musique baroque n'a-t-elle pas assouvi, à une époque, la soif nouveauté que le public ne pouvait plus étancher dans la musique contemporaine ?
C'est vrai, le besoin de nouveauté est lié à notre culture. Le souci de renouvellement des compositeurs aujourd'hui les a parfois emmenés trop loin du public. Ils ont eu à la fois la religion du progrès et l'affranchissement des contraintes économiques par le système des subventions, cela a donné une fuite dans la complexité. Et comme le public ne pouvait plus suivre mais était en même temps déterminé par le désir de nouveauté, il est allé vers les musiques anciennes. |
 |

|
En tant qu'interprète, n'êtes-vous pas également condamné à la nouveauté ?
Non, je fais ce que j'ai envie de faire avec la plus grande sincérité possible et j'ai la chance que le public me suive. Ma démarche n'est pas la recherche commerciale alors que j'ai l'impression que le marketing a largement envahi le marché du disque pour vanter des manières nouvelles de faire de la musique ancienne.
En ce moment, il y a un débat qui sévit au sujet des effectifs dans la musique de Bach. Les choeurs à un chanteur par partie conviennent sans doute bien aux oeuvres de la première période de Bach, mais sans me prononcer sur le fond, je prévois que l'on va réenregistrer toutes les cantates à un par voix, simplement parce que c'est un nouveau gadget qui va faire gloser les journalistes. |
 |
|
Revenons à Bach justement, après l'analyse que vous nous avez proposée tout à l'heure de Glenn Gould, comment imaginez-vous le profil psychologique de Bach ? Et c'est donc au psychiatre que je m'adresse...
C'est difficile √† dire, je vois avant tout quelqu'un absorb√© par le souci de qualit√©, de perfection. Je le comparerai volontiers √† Bruckner dont la qualit√© de facture aussi est tr√®s √©lev√©e. Mais dans le cas de Bruckner, le personnage est falot, il n'a pas d'existence en dehors de la musique, il a √©t√© amoureux de sa m√®re et de tr√®s jeunes filles qui passaient et n'a rien fait que d'√©crire des partitions, un peu comme Proust. Bach lui a eu une vie terrestre tr√®s contrast√©e : plusieurs femmes, une ribambelle d'enfants, il aimait le vin, la bonne ch√®re, le tabac, etc. Bach me parait un homme tr√®s √©quilibr√©, ce qui constitue une exception dans l'histoire de la musique occidentale o√Ļ les grands g√©nies √©taient tous plus ou moins d√©traqu√©s, Beethoven, Lassus, Schumann, Gesualdo ; seul peut-√™tre Mendelssohnn √©chappe √† la tourmente. Mais Bach, je l'imagine, presque avec effroi, comme quelqu'un de tr√®s √©quilibr√©. Et c'est un vrai myst√®re car en g√©n√©ral les gens tr√®s perfectionnistes sont tr√®s n√©vros√©s. Mais Bach, je pense, √©tait heureux.
3 disques pour découvrir Bach selon Philippe Herreweghe :
-Passion Selon St Mathieu Harmonia Mundi HMC 951676.78
-Magnificat. Harmonia Mundi HMC 901326
-Cantates BWV 131,73 & 105 Virgin 0777 7 59237 2 8 |
 |

|
|



