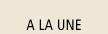

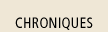

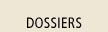

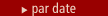
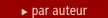
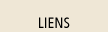
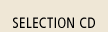
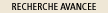

|
 |
| ENTRETIENS |
15 décembre 2025 |
 |
|
Le couplage de Cavalleria rusticana avec Sancta Susanna que vous allez diriger à l’Opéra de Paris est-il votre initiative ?
Non, c’est une idée de la direction de l’Opéra. Lorsqu’ils nous ont contacté Mario Martone et moi, alors que nous avions fait ensemble Cavalleria rusticana et Pagliacci à la Scala, c’était pour reprendre le premier dans l’idée de proposer un couplage assez inédit avec l’opéra d’Hindemith. Ce sont deux ouvrages très différents, mais je pense que cela sera intéressant pour le public de les entendre à la suite, parce que chacun est tout de même basé sur la religion catholique, même si Sancta Susanna va beaucoup plus loin que Cavalleria rusticana dans le rapport à Dieu. |
 |

|
|
Allez-vous chercher Ă tisser un lien sonore entre les deux ?
C’est impossible, car les musiques sont trop différentes, y compris pour la vocalité qui n’est pas du tout la même. Parfois, dans Cav/Pag, le ténor et le baryton sont les mêmes, donc on peut chercher à lier les histoires ou les sonorités, mais là , même sur les rôles, on ne peut combiner personne. Et puis Cavalleria est vraiment dans la tradition de l’opéra italien, avec un legato très spécifique pour la voix, alors que dans la partition d’Hindemith la mélodie est souvent à l’orchestre. Le seul lien qui existera sera dans la mise en scène, qui gardera des éléments communs, comme le Christ en croix. |
 |

|
|
C’est la quatrième fois que vous travaillez avec le metteur en scène Mario Martone.
Il y a en effet d’abord eu Matilde di Sabran à Covent Garden, Cavalleria et Pagliacci pour la Scala, et en mai dernier La Cena delle Beffe de Giordano aussi à la Scala. Cela se passe très bien car c’est un très grand metteur en scène qui sait non seulement exactement ce qu’il fait, mais qui le fait toujours en fonction de la musique. Ce n’est pas toujours le cas avec les metteurs en scène, dont certains ne font attention qu’à l’aspect visuel et pas vraiment aux chanteurs ni à la fosse.
Avec Mario, il se passe quelque chose de très profond dans le travail, notamment sur un texte comme celui de Sancta Susanna qui mérite d’être éclairci. De surcroît, la partition est pleine d’indications pour le metteur en scène, qui doivent aller avec la musique, notamment dans la gestion du temps pour réaliser les actions inscrites, en tout cas si on souhaite les suivre. |
 |
|
|
L’œuvre d’Hindemith est une première pour vous. L’abordez-vous plus comme de la musique instrumentale ou cherchez-vous en priorité le message que le compositeur a cherché à faire passer à travers sa musique ?
Je pense que les deux vont ensemble, surtout dans un opéra comme celui-ci, construit comme un grand récitatif. Il faut suivre l’expression des mots, qui doivent suivre l’action et être une réponse pratique à la situation, dans des moments qui semblent aller vers le bien et d’autres qui tendent vers le mal.
Pour un opéra difficile comme celui-ci, le chef doit être extrêmement rigoureux et travailler en combinaison avec le metteur en scène et les chanteurs. Ce n’est pas le genre d’opéra où vous pouvez dire : « Ok, c’est le tempo, on commence ! » L’expression du chant est très importante sur la portée du texte et cela est particulièrement bien écrit, tout en restant assez classique, mais comme une sorte de scène avec variations.
Par exemple au début, il y a une flûte qui tente de faire une description impressionniste du vent ; ensuite celle-ci doit venir sur scène et trouver un caractère plus terrifiant, devenir une description de ce que la vieille nonne va réaliser en ayant un rapport dangereux avec le crucifix. Cela doit produire un son sorti de nulle part. On doit travailler les notes pour la mise en place, tout en trouvant la sonorité pour faire passer le message voulu par le compositeur. |
 |

|
|
Avez-vous un rapport particulier Ă Hindemith ?
Je ne suis peut-être pas le chef idéal pour Hindemith, car il y a certainement plus connaisseur que moi, mais j’ai joué au piano beaucoup de sa musique de chambre, donc je connais bien son écriture. Pour autant, cette partition a été une surprise, notamment sa polytonalité, car comme je le disais précédemment, parfois on entend la ligne dans l’orchestre plutôt que dans la voix, un peu comme chez Schoenberg.
Et puis à Cardiff, j’ai beaucoup dirigé Richard Strauss que j’adore et qui est de la même période : Elektra, Salomé, Ariane, Rosenkavalier. D’ailleurs cet opéra d’Hindemith est le centième que je dirige. Mais bien entendu et comme souvent chez nous, on commence traditionnellement avec l’opéra italien, et je reste plus proche de Cavalleria. |
 |

|
|
Lorsque vous avez donné Giordano à la Scala, avez-vous approché sa musique comme du Mascagni ou plutôt comme Hindemith aujourd’hui, car cette musique est plus dynamique qu’on veut souvent le croire ?
Tout à fait d’accord avec vous sur la musique de Giordano, et c’est en partie pour cela je pense que La Cena delle Beffe n’a pas eu en 1914 le succès escompté, car c’est un opéra beaucoup plus dynamique dans l’écriture que ne l’est André Chénier par exemple. Harmoniquement, il est très en avance pour l’époque, avec de vraies dissonances qu’il est important de mettre en avant. Je ne l’ai donc pas approché comme une simple pièce de répertoire italien. |
 |
|
|
Quelle est votre opinion sur la question de la tradition italienne ?
La tradition peut être à double-sens mais aussi à double-tranchant, bonne comme mauvaise. Bien sûr, j’ai écouté ce que l’on a fait avant moi, mais il ne faut pas tenter de copier. Parfois, certains chanteurs arrivent et veulent absolument chanter les grands aigus de la tradition. Mais si cela n’est pas dans la ligne de l’opéra, ce n’est pas nécessaire, bien qu’on les entende souvent sur scène. Certains opéras, notamment chez Verdi, ont une très mauvaise tradition que je remets en cause, et qui a par exemple beaucoup déformé Rigoletto.
Lors du duo entre le Duc et de Gilda, il y a souvent une coupure dans la cadence, or je pense que cette dernière a une vraie raison d’être et ne doit pas être écourtée. D’ailleurs pour anecdote, lorsque j’ai donné cette cadence au Met, les chanteurs étaient ravis, mais un des musiciens de l’orchestre m’a demandé : « Avez-vous écrit vous-même cette cadence ? » et moi de répliquer « Non ! C’est Verdi », ce à quoi il m’a répondu : « Ah ? Eh bien je ne l’aime pas ! »
Ă€ voir :
Cavalleria rusticana de Mascagni et Sancta Susanna d’Hindemith, mise en scène Mario Martone, direction Carlo Rizzi, Opéra Bastille, Paris, du 30 novembre au 23 décembre 2016. |
 |

|
|



