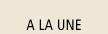

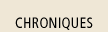

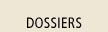

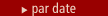
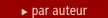
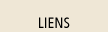
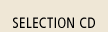
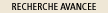

|
 |
| ENTRETIENS |
08 juillet 2025 |
 |
Alexandre Duhamel,
l’Écho éclos
Dans Mireille nous parvenait son Écho. Depuis, pas une production de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris où Alexandre Duhamel ne se soit fait remarquer. Par le timbre, baryton percutant au grain profond, la présence, mieux, la stature, et, qualité inestimable, une diction qui porte loin. Il est Wagner dans la nouvelle production de Faust de Gounod.
|
 |

Ted Huffman,
artiste de l’imaginaireJérôme Brunetière,
l’opéra pour tous à ToulonJean-Baptiste Doulcet,
romantique assumé [ Tous les entretiens ]
|
|
Après deux années dans le cocon de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris, vous vous retrouvez seul face à la réalité du métier de chanteur.
J’ai ressenti une certaine pression cet été. Désormais, il faut être irréprochable, je n’ai plus l’excuse d’être étudiant : je dois être professionnel de A à Z. L’Atelier constitue à cet égard une transition très douce, car j’ai eu la chance de faire beaucoup de petits rôles avec des chefs et des partenaires excellents. Cela m’a mis sur la voie. |
 |

|
|
Quelles sont les différences entre l’enseignement du Conservatoire et la formation prodiguée à l’Atelier Lyrique ?
J’ai participé à quelques productions au Conservatoire, mais on y étudie principalement le solfège et la technique. Il n’en est plus vraiment question à l’Atelier Lyrique, où l’on se concentre sur l’interprétation, l’étude de rôles, et la constitution d’un répertoire. On a vraiment l’impression d’être dans le métier. |
 |

|
|
Comment a évolué votre voix depuis votre sortie du Conservatoire ?
Elle s’est vraiment développée. Avant, je chantais sans trop me poser de questions, je ne savais pas toujours ce que je faisais. Mais le niveau d’exigence de l’Atelier ne permet pas de pousser sur un aigu, ou d’avoir des problèmes d’intonation. L’excellence des autres chanteurs m’a donné l’énergie d’essayer d’être chaque jour meilleur. Et puis, je continue à voir mon professeur deux fois par mois. Je vais chez elle en Angleterre, et nous travaillons intensivement pendant trois jours. J’ai appris à être beaucoup plus exigeant avec moi-même, à ne plus recevoir la becquée, en somme à devenir mon propre professeur. |
 |
|
|
Cette progression vous a-t-elle mené dans des directions auxquelles vous ne vous attendiez pas ?
J’ai pris mes premières leçons de chant comme ténor. Ensuite, j’ai été basse, puis baryton-basse. Ma voix s’est construite à partir du grave et du bas-médium, mais je ne pensais pas devenir baryton, voire baryton lyrique. Je me rends compte que plus la technique, l’endurance se développent, plus je sollicite l’aigu.
Je m’imaginais beaucoup chanter Mozart, Leporello, Guglielmo, des rôles souvent tenus par des barytons-basses, mais on me confie de plus en plus du répertoire de baryton français. Cela tombe bien, car c’est celui que j’aime le plus, et c’est à nous de le défendre. Je ferai Moralès à l’Opéra l’année prochaine, et Zurga, Athanaël, Escamillo sont parmi les rôles que j’aimerais aborder. |
 |

|
|
Dans ce registre, la concurrence est assez rude. Comment se démarque-t-on ?
Pour commencer à se défendre dans la jungle des chanteurs d’opéra, un agent est indispensable. J’en ai trouvé un grâce au concert que l’Atelier Lyrique donne chaque année au Palais Garnier. Il m’a entendu chanter l’air de Sancho dans Don Quichotte de Massenet, et c’est ainsi qu’a débuté notre collaboration.
Plus spécifiquement, lorsque l’on chante en français, non seulement la diction, mais le sens des mots, du texte sont primordiaux. Je suis émerveillé d’entendre Alagna dans Faust. J’ai également beaucoup appris en observant Alain Vernhes, qui m’a d’ailleurs donné plein de conseils lorsque je travaillais Sancho. |
 |

|
|
L’Atelier Lyrique vous permet de tisser des liens privilégiés avec l’Opéra de Paris, mais qu’en est-il des autres théâtres ?
Qu’est-ce qui fait qu’on a davantage de chance que d’autres d’être sur scène ? C’est le travail. Il faut capter l’oreille des directeurs à chaque fois que l’on se produit, leur montrer que l’on est digne de confiance. À l’Opéra de Paris, je me suis d’abord vu confier l’Écho, puis un mot dans Werther, une phrase dans Gianni Schicchi, une page dans Francesca da Rimini, à présent un petit air, qui aurait pu être plus long, à la manière de la chanson de Brander dans la Damnation de Faust, s’il n’était interrompu par Méphisto…
Cela marche aussi beaucoup par auditions. Raymond Duffaut m’a engagé pour Mercutio dans Roméo et Juliette la saison prochaine à l’Opéra d’Avignon. Éric Chevalier, qui était dans mon jury de fin d’année au Conservatoire, m’a proposé Valentin à Metz. J’ai également eu la chance de participer à des productions intéressantes au Conservatoire, pour lesquelles les directeurs de théâtres se déplacent. |
 |

|
|
Comment vous êtes-vous senti lorsque vous vous avez chanté pour la première fois au Palais Garnier, dans Mireille ?
J’étais vraiment surexcité. C’était d’autant plus magique que je ne m’attendais pas à chanter l’Écho. Mais il se trouvait que ma voix allait mieux avec celle de Franck Ferrari que celle du chanteur prévu à l’origine. On se sent très petit quand on débarque du Conservatoire dans une salle pareille. Cela m’a vraiment stimulé : il fallait que je sois à la hauteur, que je travaille deux fois plus. |
 |

|
|
C’est aussi une situation de spectateur privilégié.
Au Conservatoire, je rêvais de pouvoir aller de temps en temps dans les coulisses de l’Opéra de Paris, pour écouter et regarder. Il n’en est pas moins stressant de ne chanter que quelques mots, parce que c’est la seule occasion de se défendre. |
 |

|
|
Qu’avez-vous appris au contact des grands chanteurs ?
J’ai pu observer le calme absolu de Jonas Kaufmann. Jamais il ne paraît inquiet, alors même qu’il était malade pendant les représentations de Werther. Dans sa loge, il toussait comme un fou, mais sur scène, il n’avait aucun problème, ni la moindre tension dans le front, le cou, les épaules. Les grands chanteurs ne parviennent pas à ce niveau pour rien. Ils sont tellement posés, constants. Et certains interprètes sont incroyablement habités, Roberto Alagna dans Francesca da Rimini par exemple. |
 |

|
|
Qui sont vos modèles ?
J’en ai beaucoup, et il me semble très important d’avoir des modèles qui parlent la même langue maternelle que soi. J’ai donc beaucoup de modèles français : Alain Fondary, avec qui je travaille régulièrement, Alain Vernhes, Ludovic Tézier, Franck Ferrari. Et il se passe rarement une journée sans que j’écoute Ernest Blanc. |
 |

|
|
La tentation peut ĂŞtre grande de les imiter.
Avec une bonne connexion au niveau du souffle et de vraies voyelles françaises pures, il y a peu de chances d’imiter quelqu’un d’autre. J’écoute principalement la manière dont ces grands barytons abordent l’aigu. Il est vrai que durant mes deux premières années au Conservatoire, j’avais du mal à vivre sans écouter Bryn Terfel, car tout ce qu’il aborde semble avoir été écrit pour lui. Il est bon d’avoir des modèles, mais il faut savoir s’en détacher, trouver sa propre interprétation et y mettre sa personnalité. |
 |

|
|
Qu’est-ce qui vous a décidé à pousser la porte d’un conservatoire ?
L’amour de la scène. Tout petit déjà , j’avais besoin d’un public. J’ai fait beaucoup de théâtre au lycée, et j’aimais les chanteurs français à voix, comme Michel Sardou, Yves Montand, Serge Reggiani, qui sont d’ailleurs tous des barytons. Mon rêve, lorsque j’avais sept ou huit ans, était de devenir chanteur de variétés, mais jamais je ne l’aurais avoué.
J’ai découvert la musique classique en voyant un film le film Ludwig van B. avec Gary Oldman. Ce fut un véritable déclic. Au moment de la mue, j’ai commencé à écouter de l’opéra, des compilations, avec une prédilection pour Pavarotti. Je rêvais d’être ténor et de chanter les mélodies napolitaines. Je suis entré dans un conservatoire municipal où je n’avais qu’une demi-heure de cours par semaine. J’ai donc fait des études de journalisme en parallèle. C’est en intégrant le CNSM que j’ai pris la décision de faire du chant mon métier. |
 |

|
|
Un métier où il faut désormais être prêt à tout sur le plan scénique.
Un jeune chanteur peut difficilement se permettre de refuser les directives d’un metteur en scène. Mais si on me demande d’être nu ou en string sur scène, je ne suis pas certain d’accepter. Pour l’instant j’ai toujours travaillé avec des metteurs en scène assez conventionnels, et j’en suis assez content. Car à l’opéra, je vais entendre de belles voix, j’aime pouvoir fermer les yeux et être envoûté. |
 |
|
|
Vous avez reçu de nombreux prix, et avez même été nommé aux Victoires de la Musique ?
C’est la première fois que j’étais aussi exposé, et il m’a fallu un certain temps pour m’y habituer. Parce que des gens nous jugent, votent pour nous, des vidéos sont diffusées sur Internet, avec des commentaires pas toujours très élogieux. Cela m’a beaucoup stimulé, et j’ai eu envie de prouver, d’abord à moi-même, que j’étais capable de bien faire, d’être crédible et d’avoir ma place dans ce métier. Recevoir un prix est toujours encourageant, mais cela ne me touche pas plus que cela, car je suis mon critique le plus sévère. Ce qui me rend le plus heureux, c’est que j’arrive aujourd’hui à chanter Zurga sans me fatiguer, alors qu’il y a encore un ou deux ans, j’étais content d’en venir à bout.
Ă€ voir :
Faust de Gounod, direction : Alain Altinoglu, mise en scène : Jean-Louis Martinoty, Opéra Bastille, du 22 septembre au 25 octobre.
Concert des Révélations Classiques de l’Adami, Théâtre des Bouffes du Nord, 17 octobre. |
 |

|
|



